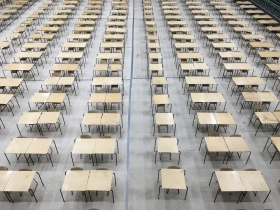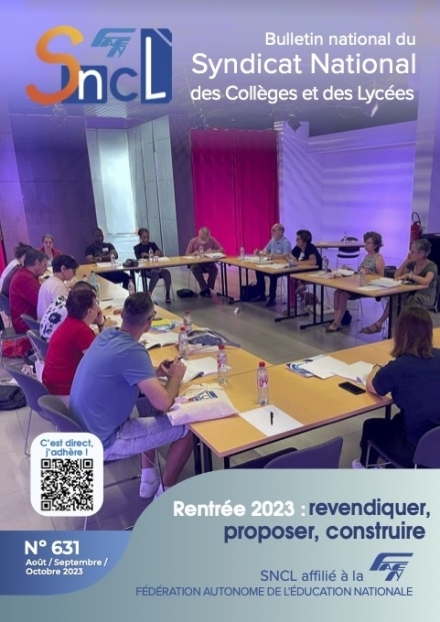Nombre d’entre elles ont un fondement pédagogique développé dans la présente « Résolution ».
Le SNCL-FAEN déplore que le service public d’éducation fasse les frais de réformes élaborées à la hâte et sans concertation qui ne vont pas dans l’intérêt des élèves et des personnels et qui ont pour seul objectif des économies budgétaires.
Par conséquent, il demande au Gouvernement et au Parlement de donner au service public d’éducation et à ses personnels les moyens d’exercer convenablement leur profession parce que l’éducation des jeunes constitue avant tout un investissement dans l’avenir de la Nation.
Cela passe par un véritable dialogue social renouvelé avec toutes les organisations syndicales, l’abandon d’une politique éducative subordonnée à des contingences budgétaires, par le recrutement de personnels titulaires en nombre suffisant et l’amélioration de leurs conditions de travail.
Le SNCL-FAEN rejette le recours systématique à des personnels contractuels insuffisamment formés, peu considérés et mal rémunérés et demande au Gouvernement la mise en place d’une réelle politique de recrutement de titulaires pour pallier le nombre important de départs en retraite dans les années à venir.
Le SNCL-FAEN met en garde contre le développement de la précarisation des personnels de l’Education nationale.
Le SNCL-FAEN demande un plan de titularisation des contractuels afin de limiter cette précarisation de nos métiers.
LES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX DANS LE PREMIER DEGRE
La maîtrise des moyens universels de communication est indispensable à l’acquisition des autres savoirs :
– la lecture et la compréhension de l’écrit,
– l’expression orale,
– l’écriture,
– les principaux modes opératoires et la géométrie plane en mathématiques,
– la familiarisation et l’utilisation des technologies informatiques de communication,
– la pratique d’une langue étrangère,
– l’éveil à la culture, à la démarche scientifique, aux arts et à la pratique des activités sportives.
Leur apprentissage et leur assimilation dès l’école primaire constituent donc une priorité absolue pour suivre avec profit la scolarité au collège puis au lycée.
La détection précoce et systématique des difficultés des élèves dans ces apprentissages doit être organisée avec une prise en charge adaptée à chacun d’entre eux qui doit être prévue avec l’aide d’équipes pluri-professionnelles (pédagogiques, éducatives, sociales, médicales, …).
L’apprentissage des technologies informatiques de communication doit s’accompagner d’une éducation visant à développer un esprit critique vis-à-vis de l’utilisation des médias, d’Internet et des réseaux sociaux, notamment la problématique de cyberdépendance grandissante chez certains élèves.
L’acquisition des savoirs fondamentaux ne doit pas occulter le besoin d’enrichissement culturel et linguistique que le service public d’éducation a le devoir d’assurer, et ce, afin de rendre inutile le recours aux organismes de formation privés qui aggrave encore la fracture sociale et creuse les inégalités.
EN COLLEGE
Le collège accueille la quasi-totalité des élèves à l’issue de l’école primaire, dans un contexte social et éducatif de plus en plus difficile. Le SNCL-FAEN a fait depuis longtemps ce constat sans appel : le collège unique ne parvient pas à assurer la réussite de tous les élèves et les professeurs qui y enseignent ont de plus en plus de difficultés à exercer leur métier de manière sereine et profitable.
Les raisons principales de cet échec sont notamment :
- les restrictions budgétaires continues ayant pour conséquence l’aggravation des conditions de travail et d’enseignement,
- la réduction du nombre des heures d’enseignement, notamment avec la réforme du collège,
- la suppression progressive des voies diversifiées qui permettaient de prendre réellement en charge tous les élèves,
- l’abandon d’un grand nombre d’exigences de niveau et de comportement pour masquer les conséquences d’une mauvaise politique éducative,
- l’empilement des réformes de l’éducation depuis 30 ans et les moyens injectés qui n’ont pas permis de réduire les inégalités et les ont même aggravées,
- l’arrivée massive d’enfants relevant de SEGPA ou de centres médicaux pédagogiques, d’enfants en très grande difficulté personnelle et scolaire ou souffrant de troubles de type « dys » dans des classes à effectifs non allégés,
- une formation initiale insuffisante des enseignants pour prendre en charge la problématique « dys »,
- l’affectation trop rapide d’enfants avec une maîtrise insuffisante de la langue française dans des classes non spécialisées,
- l’accueil de plus en plus d’élèves ne maîtrisant pas les apprentissages fondamentaux,
Ainsi la loi de programmation et d’orientation pour la refondation de l’Ecole apparaît inadaptée aux réalités actuelles du collège.
Le SNCL-FAEN dénonce :
- la réforme du collège de 2016,
- le renforcement au fil des années du collège unique, devenu uniforme, qui a conduit à son échec et, pire encore, la dérive que constituent aujourd’hui les « établissements ou écoles du socle » aboutissant à une primarisation du collège et donc un retour de 50 ans en arrière,
- la politique du chiffre imposée aux établissements (taux de redoublement, réussite au DNB, etc.) et la pression engendrée par cette recherche du « bon classement »,
- le caractère très réducteur et minimaliste du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui ne permet pas à chaque élève de valoriser au maximum ses possibilités,
- le pouvoir renforcé du conseil pédagogique qui limite la liberté pédagogique des enseignants et impose des décisions prises par un petit nombre,
- l’absence de pouvoirs décisionnels des conseils de classes, l’obligation de travailler en interdisciplinarité, la nouvelle organisation des programmes par cycles et non plus par année d’enseignement,
- l’accroissement des pouvoirs des chefs d’établissement,
- la globalisation des enseignements qui a pour conséquence l’appauvrissement, voire la disparition de certaines disciplines,
- l’empilement des dispositifs d’éducation prioritaire, sans réelle cohérence les uns avec les autres conduisant à une politique éducative discutable,
- les « bricolages pédagogiques » locaux, faute de moyens suffisants, pour mettre en place notamment les ATPE (Aide au Travail Personnalisé de l’Elève) et autres PPRE (Projets Personnalisés de Réussite Educative),
- le relâchement face au respect des règles (et du règlement) faisant que la parole de l’élève et celle des parents peuvent avoir plus de poids que celle de l’équipe éducative,
- la minimisation de la gravité de certains faits assortie parfois de l’absence même de sanctions,
- la mise en place progressive des EPSF (Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux) qui regrouperont les classes d’un collège et de plusieurs écoles situées dans un même bassin et qui seront dirigées par un personnel de direction de collège.
Constats et revendications du SNCL-FAEN :
Afin que le Collège puisse transmettre et structurer les savoirs généraux nécessaires à la poursuite d’études ou de formations ultérieures ainsi qu’à l’insertion sociale des futurs citoyens, le SNCL-FAEN formule avec insistance des revendications ambitieuses pour le Collège. Il réclame les moyens (horaires, humains et financiers) indispensables à la mise en place de parcours de formation diversifiés, le tout dans un cadre national.
La mise en place de collèges à taille humaine (ne pouvant en aucun cas dépasser 600 élèves) avec un taux d’encadrement suffisant (professeurs, personnels d’éducation, personnels administratifs, infirmiers, assistants sociaux, conseillers d’orientation psychologues de l’Education nationale (PsyEN), …
- L’évaluation régulière et réaliste des acquis des élèves et de leurs difficultés.
- L’abandon de l’évaluation sommative par compétences, opaque et peu lisible, par un retour à la notation chiffrée.
- L’abandon du LSU qui alourdit la charge de travail des personnels sans améliorer l’évaluation des élèves.
- La prise en charge immédiate des difficultés décelées chez les élèves par un enseignement plus individualisé, notamment par le biais de classes semi-hétérogènes, fonctionnant en petits groupes, avec un horaire renforcé.
- L’organisation d’un véritable accompagnement éducatif pour tous les élèves.
- Le maintien de la SEGPA en tant que structure adaptée du collège, dotée de moyens horaires spécifiques, d’un budget particulier et de postes occupés par un personnel qualifié qui permet l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des élèves en grande difficulté relevant de cette structure notamment par l’obtention d’un CFG et des notions de base pour suivre une formation, en lycée ou par la voie de l’apprentissage, en vue de l’acquisition d’un CAP, d’un Bac Pro ou d’une partie de ceux-ci.
- Le développement de l’enseignement des valeurs de la République, des fondements de la citoyenneté et des règles de comportement et du « vivre ensemble ».
- La création de groupes d’approfondissement, destinés aux élèves volontaires pour permettre à chacun d’entre eux d’aller au maximum de ses possibilités dans le cadre du service public d’éducation.
- La diversification, à partir de la classe de quatrième, des parcours de formation des élèves sous statut de collégien, seul remède pour donner un bon niveau de formation générale et permettre le choix d’une formation professionnelle par tous les élèves qui le souhaitent.
- Le retour de l’option DP3 en classe de 3ème découverte professionnelle 3 heures qui permettait à de nombreux élèves curieux de découvrir le monde professionnel afin de réfléchir à leur orientation.
La scolarisation dans des structures adaptées (dispositifs relais, centres éducatifs fermés, établissements pour élèves perturbateurs, ITEP – institut thérapeutique éducatif et pédagogique, internats, etc.) créées en nombre suffisant pour accueillir temporairement des élèves en situation de refus scolaire et qui arrivent à perturber gravement le fonctionnement des classes et des établissements.
DANS LES LYCEES
Tous les lycées, qu’ils soient polyvalents, généraux et technologiques, professionnels, ou encore labellisés « lycées des métiers » doivent permettre à tous les élèves sortant du collège non seulement d’acquérir les bases nécessaires à la poursuite d’études supérieures ou à l’insertion dans le monde du travail mais également d’en faire des citoyens responsables occupant toute leur place dans la société.
Chaque élève, qu’il soit orienté vers un cycle court ou un cycle long en voie générale, technologique ou professionnelle, doit avoir la possibilité de sortir du système éducatif avec un diplôme reconnu, de poursuivre ou de reprendre ses études afin d’améliorer sa formation, sa qualification ou de réaliser sa reconversion professionnelle.
L’insuffisance des moyens horaires, notamment pour les dédoublements, instaure une concurrence exacerbée entre les disciplines.
La mise en place du « droit à l’erreur » dans l’orientation aurait pu avoir un intérêt s’il avait été accompagné de la mise en place des passerelles destinées à permettre la réorientation.
Les gouvernements successifs ont certes identifié le problème mais, contrainte budgétaire oblige, n’ont pas apporté les moyens d’y porter remède.
L’expérimentation du « dernier mot aux parents » instaurée afin de lutter contre les échecs d’orientation des élèves s’est soldée par un bilan négatif.
Aucun changement ne s’est avéré significatif par rapport à la situation antérieure.
La mise en place de l’accompagnement personnalisé était, sur le papier, une bonne mesure pour répondre à l’hétérogénéité des classes, mais son application n’a été qu’affichage et bricolage.
Le passage collège/lycée
Le collégien qui entre au lycée découvre un monde nouveau de liberté à l’âge difficile de l’adolescence. Le manque de maturité, le manque d’investissement, le manque d’intérêt, le manque de soutien familial, le manque de véritable projet personnel et professionnel que l’on observe parfois constituent autant de facteurs d’échec dès la seconde.
Le SNCL-FAEN demande des lycées de taille humaine (1 200 élèves maximum) avec un taux d’encadrement suffisant (professeurs, personnels d’éducation, personnels administratifs, infirmiers, assistants sociaux, psychologues de l’Education nationale (PsyEN), …, des équipements adaptés dans un cadre de vie sécurisé et agréable devraient faciliter l’intégration et la réussite de tous.
Le SNCL-FAEN demande le maintien d’un véritable examen national de cycle terminal marquant ainsi la fin des études secondaires et attestant d’un niveau de savoirs et de savoir-faire indispensables à une fructueuse poursuite dans l’enseignement supérieur.
Le SNCL-FAEN dénonce la suppression des filières L, S et ES dans les lycées d’enseignement général et l’évaluation du baccalauréat sous forme de contrôle continu ce qui va accentuer la concurrence entre établissements et creuser la fracture sociale et territoriale.
Le SNCL-FAEN dénonce le remplacement des filières par des enseignements de spécialité qui ne sont pas présents dans tous les lycées et ce qui restreint la possibilité de choix.
Le SNCL-FAEN dénonce le risque de disparition de facto des DNL, des options et des langues rares et régionales induite par la réforme des lycées.
La nouvelle réforme des lycées :
Le SNCL-FAEN déplore le fait que cette nouvelle réforme intervienne sans qu’aucun bilan sérieux n’ait été fait de la réforme précédente.
Le SNCL-FAEN dénonce le fait que cette réforme ait été menée à marche forcée sans réelle concertation ou négociation avec les personnels.
Le SNCL-FAEN regrette que cette nouvelle réforme ait été imposée de façon précipitée sans que les personnels aient été suffisamment formés et informés.
Dans le voie générale et technologique
Aucun bilan crédible et fiable n’a été tiré de la réforme de 2010.
La réforme des lycées qui vient d’être mise en place et du baccalauréat suscite notre inquiétude : elle va se traduire par une régression culturelle avec une diminution considérable de l’horaire élève et la disparition d’options, un alourdissement des classes, une forte hétérogénéité ainsi la mise en concurrence des enseignements de spécialité et des établissements.
Dans tous les cas, elle provoque des fermetures de postes qui mettent en péril certaines disciplines et qui contraignent leurs professeurs à des mesures de carte scolaire et à des compléments de service sur 2 voire 3 établissements.
Le choix des spécialités en remplacement des filières dès la classe de seconde risque d’entraîner des difficultés d’orientation. Le choix est trop précoce et prématuré : il va conditionner l’orientation.
La disparition des séries au profit d’un « tronc commun » et de « spécialités » à choisir dès la fin de la classe de seconde oblige les élèves à faire des choix d’orientation prématurés sans réelle possibilité de revenir en arrière en cas d’erreur.
L’offre de « spécialités », finalement inégale selon les lycées et les territoires conduira nombre de lycéens à faire des choix contraints en fonction des possibilités locales d’enseignement et non en fonction de leurs aspirations réelles.
La réforme du baccalauréat en vigueur à la session 2021 conduira à des diplômes locaux ce qui lui fera perdre son caractère national.
Dans la voie professionnelle
La réforme des lycées de 2019 aura de graves conséquences sur l’enseignement professionnel et va entraîner une dégradation sans précédent.
Le SNCL-FAEN dénonce :
– le regroupement de plusieurs spécialités professionnelles en classes de seconde à orientation progressive, ce qui entraînera une déspécialisation des baccalauréats professionnels.
– Une baisse sans précédent des volumes horaires des enseignements disciplinaires, ce qui rendra plus difficile la poursuite d’étude en BTS.
– La volonté de plus en plus récurrente de l’administration d’imposer des étudiants (salariés) en alternance dans les classes de BTS en lycée général et technologique provoquant des difficultés d’organisation.
– La déprofessionnalisation du baccalauréat professionnel et sa durée de préparation sur 2 années au lieu de 3 ce qui entraîne la réduction d’une année l’enseignement professionnel de spécialité.
Le SNCL-FAEN réclame :
– des moyens pour améliorer les conditions de travail et permettre la réussite des élèves avec un seuil maximal de 20 élèves par classe en Bac pro,
– la mise en place de classes passerelles du Bac pro vers le BTS pour permettre aux élèves de consolider leur parcours avec une année de formation spécifique de façon à limiter l’échec en BTS et permettre la réussite de tous.
Dans toutes les voies
Les réformes engagées, tant en voie générale qu’en voie technologique ou professionnelle répondent à une logique comptable et ont pour finalité de faire des économies budgétaires mais elles auront des répercussions catastrophiques sur le plan de la formation et sur le plan humain.
Le SNCL-FAEN estime que pour remplir correctement leur mission, les lycées doivent bénéficier de moyens spécifiques :
- des classes n’excédant pas 30 élèves et systématiquement dédoublées dans les matières expérimentales et en langues vivantes,
- la réelle possibilité de choisir ses enseignements de spécialité sans que le choix ne soit imposé à l’élève,
- le retour des options et le maintien de l’enseignement de langues anciennes et rares.
De plus, le SNCL-FAEN demande :
- des programmes nationaux établis après concertation avec les équipes de terrain, plus adaptés aux réalités du quotidien et en cohérence avec les autres disciplines. Ils doivent fixer des objectifs de connaissance et de savoir-faire en liaison entre les cycles et en corrélation avec l’examen terminal. Ils doivent permettre des adaptations aux spécificités locales,
- des emplois du temps des élèves équilibrés et facilitant leur capacité d’attention,
- des plages horaires communes par niveau pour la pratique d’activités périscolaires (clubs, projets,…),
- une véritable coupure de 1 heure 30 minimum entre matinée et après-midi,
- un savoir-faire pris en compte dans l’examen final, notamment dans les disciplines expérimentales, et évalué par des professeurs extérieurs à l’établissement,
- le maintien du palier d’orientation en fin de seconde générale sans qu’il ne pénalise les élèves,
- un cycle terminal jouant son rôle de préparation à l’examen final, à l’acquisition de la citoyenneté et à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
- la reconnaissance officielle explicite de l’égalité de valeur des formations dispensées dans les lycées professionnels et dans les autres types d’établissement du second degré,
- l’instauration de véritables passerelles entre les voies générale, technologique et professionnelle et la mise en place de modules de remise à niveau assurant la réussite de ces réorientations en cours de formation,
- le maintien du diplôme du baccalauréat en tant qu’examen national, terminal et anonyme, permettant l’accès à l’université,
la fin des CCF à tous les niveaux de l’évaluation et le retour à un examen national et non local.
Pour une plus grande efficacité pédagogique
L’amélioration du fonctionnement des écoles, des collèges et des lycées passe à la fois par une clarification de leurs missions, une réorganisation de la scolarité des élèves et par l’amélioration des conditions de travail des personnels.
Le SNCL-FAEN demande notamment :
- la promulgation d’une loi qui interdirait toute nouvelle réforme avant que la précédente ait été mise en place complètement et évaluée par un groupe d’experts indépendants reconnus par la profession,
- le droit au travail dans la sérénité, en toute sécurité dans tous les établissements, ce qui passe par le respect des personnes et des règles de civilité notamment par l’application du règlement intérieur, par le rétablissement de la discipline ainsi que par la lutte contre toute forme de violence et le soutien automatique de la hiérarchie en proposant la protection fonctionnelle dès lors que la victime en a besoin,
- la Dotation Horaire Globale doit permettre d’assurer en heures poste tous les enseignements disciplinaires, dans la totalité de leur horaire officiel, ainsi que les besoins réels de l’établissement,
- un bilan de la politique des cycles avant leur éventuel maintien, modification ou suppression,
- l’obligation de réaliser des établissements scolaires de taille humaine avec un maximum de 600 élèves en collège et de 1 200 élèves en lycée. Ces bâtiments construits par les collectivités territoriales selon des normes strictes édictées par l’État devront être dotés des matériels pédagogiques nécessaires, d’ateliers, d’équipements divers (y compris de restauration scolaire) et de salles adaptées aux différentes activités et formations dispensées,
- la dotation de tous les établissements en matériels et en moyens d’information et de communication adaptés à l’évolution des technologies,
- la prise en compte de l’évolution du métier dans la définition du service des professeurs, en collège (SEGPA incluse) comme en lycée et en EREA, la définition dans toutes les disciplines d’un service global hebdomadaire de 18 heures et 15 heures pour les agrégés, dont 1/6 sera consacré à la concertation, à l’heure de vie de classe et au suivi plus individualisé des élèves,
- l’indispensable allègement de l’effectif des classes et la multiplication des groupes à effectifs réduits afin de rétablir des conditions d’enseignement et de discipline convenables et répondre aux problèmes liés à la trop grande hétérogénéité des classes par :
– l’ouverture systématique de nouvelles classes de manière à ce qu’aucune d’elles ne compte plus de 24 élèves en collège et en lycée professionnel, 30 élèves en lycée général et technologique,
– l’abaissement de ces maxima :
- dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire ou qui rencontrent des difficultés particulières,
- dans les classes qui prennent en charge des élèves en grande difficulté,
– pour les classes intégrant des élèves handicapés, la reconnaissance de la surcharge de travail qui en découle pour les enseignants, la nécessité de formation et d’information pour l’ensemble des personnels concernés, la présence indispensable d’assistants de vie scolaire mieux formés et mieux rémunérés,
– la possibilité de mettre deux professeurs par classe dans les situations particulières qui le nécessitent,
– la limitation, pour les SEGPA, à 15 élèves en enseignement général et à 8 en atelier,
- des CDI mieux dotés, mieux équipés, la création de nombreux postes et l’augmentation du recrutement de professeurs documentalistes titulaires afin d’élargir les plages horaires d’ouvertures,
- le renforcement des équipes éducatives placées sous la responsabilité du CPE, dans chaque établissement par la création d’un corps de personnels de titulaires formés,
- l’attribution d’une heure de décharge de service à chaque professeur principal pour lui permettre d’assurer les nombreuses tâches supplémentaires qui lui ont été imposées ces dernières années sans remettre en cause le paiement de l’ISOE,
- le recrutement et l’affectation de personnels titulaires spécialisés pour assurer la maintenance et le fonctionnement des réseaux informatiques, devenus indispensables,
- l’affectation de personnels de laboratoire qualifiés en SVT et en physique/chimie dans tous les établissements,
- une meilleure reconnaissance et prise en compte par les programmes scolaires, dans le cadre national, des réalités historiques, culturelles et linguistiques régionales,
- de meilleures liaisons école-collège, collège-lycées et lycée-enseignement supérieur pour un suivi plus efficace des élèves. Le travail qui en découle doit être inclus dans l’horaire de service statutaire actuel des professeurs,
- la création de locaux adaptés et fonctionnels avec le développement de points TICE, de salles d’études, de lecture ou multimédia surveillées, de salles de travaux pratiques équipées en informatique,
- la saisie des notes par les professeurs facilitée par l’utilisation généralisée d’un seul et même logiciel et à partir de n’importe quel poste informatique en liaison Internet, avec notamment l’adoption par l’éducation nationale d’un ENT (espace numérique de travail) , commun à tous les établissements de la même académie,
- des équipements sportifs de proximité de qualité, répondant aux normes de sécurité et permettant la pratique du plus grand nombre d’activités sportives dans le cadre des programmes mais aussi de l’UNSS,
- des structures d’hébergement rénovées permettant aux élèves internes d’effectuer leurs études dans les meilleures conditions,
- des créations d’internats en collèges et en lycées, plus particulièrement en zones rurales, avec le personnel nécessaire à leur fonctionnement.
(Suite de notre résolution pédagogique ici)