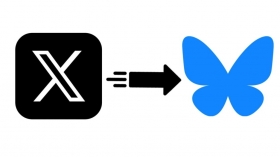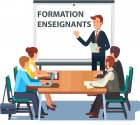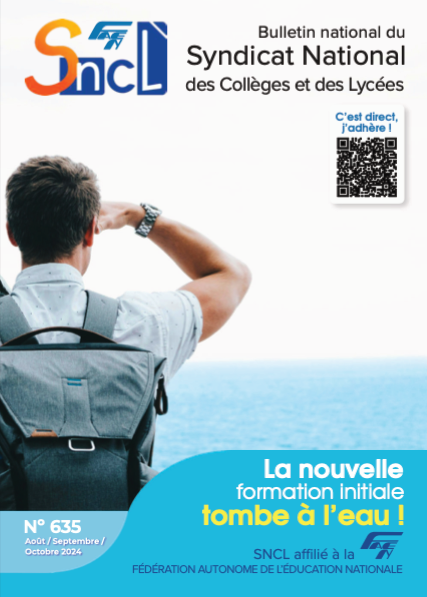Le SNCL vous a préparé ce dossier pour mieux connaitre vos droits et prendre soin de vous tout au long de l’année. Découvrez d’abord les résultats de notre test sur l’accès à la médecine du travail, puis retrouvez toutes les informations utiles grâce à notre fiche mémento.
- Accès à la médecine préventive : les résultats préoccupants de notre test
- Fiche mémento : tout savoir sur la médecine du travail et sur vos droits
I. Accès à la médecine préventive : les résultats préoccupants de notre test
Notre syndicat a voulu tester l’accessibilité des informations académiques concernant le service de médecine préventive.
La méthode était la suivante : sur la page de contact des académies (site education.gouv.fr), Nous avons choisi chacune des 34 académies et saisi la recherche « médecine de prévention ».
L’organisation réglementaire prévoit normalement que tout service de médecine préventive académique soit coordonné par un médecin du travail, assisté d’infirmiers en santé au travail, et composé en outre de médecins collaborateurs généralement appelés « médecins de prévention ».
Premier constat : symptomatique du manque criant de personnel : la plupart des sites académiques répondent à la recherche en donnant accès à des fiches métiers sur la profession de médecin du travail dans la Fonction publique et de médecins scolaires ainsi que des offres d’emploi pour ces métiers.
Deuxième constat : seules 3 académies sur 34 sont en capacité de publier le nom d’un médecin du travail ; il s’agit de la Corse, de La Réunion et de Reims. Il semble donc que 31 académies ne possèdent plus de médecin du travail coordonnateur de la médecine préventive.
D’ailleurs, notre syndicat a fait plusieurs fois le test en demandant à voir le médecin du travail et la réponse a toujours été la même, celle d’une orientation vers le médecin « de prévention » sans plus de détails.
Certaines FSSSCT (formations spécialisées en santé, sécurité et conditions de travail) n’ont jamais répondu non plus à notre demande syndicale d’identification du médecin du travail de l’académie.
Troisième constat : s’il existe des infirmières en médecine préventive, très peu sont spécialisées en santé au travail. Là encore seules trois académies publient l’identité d’infirmières en santé au travail, par la méthode que nous avons indiquée.
Quatrième constat : en ce qui concerne l’accessibilité des données au sujet des médecins de prévention, il n’existe pratiquement pas de résultat global académique. Bien souvent les réponses à notre recherche impliquent de chercher quelques données supplémentaires dans les publications des DSDEN de l’académie.
Il n’existe donc pas de documents académiques officiels intitulés « Service de médecine de prévention », sauf pour l’académie de Corse, vraiment exemplaire sur ce point. On y trouve réuni sur une même page, le nom du médecin du travail, celui du médecin conseiller technique du recteur, celui des 3 conseillers de prévention et des 12 assistants de prévention.
Cinquième constat : en cherchant un peu, on parvient par notre méthode à être renvoyé sur des pages de contact avec la médecine préventive académique ou départementale, mais à part le titre de médecin de prévention, bien peu d’académies sont capables de publier autre chose qu’un mail générique de médecine préventive ou de secrétariat.
Sixième constat : par notre méthode, 19 académies ne publient aucune information directement en lien avec le service de médecine préventive des personnels.
Septième constat : beaucoup de sites académiques se contentent d’énumérer les missions de cette médecine de prévention, textes à l’appui, plutôt que d’identifier les personnes ressources.
Ajoutons à cela que les collègues les plus expérimentés viennent de passer leurs trente dernières années au travail sans convocation du médecin de prévention. Il y a péril en la demeure, mépris du droit de plus d’un million de travailleurs !
Le SNCL dénonce un tel abandon de la médecine de prévention à commencer par la disparition du médecin et de l’infirmier du travail.
Le SNCL dénonce aussi l’absence de transparence dans la communication de documents récapitulatifs des moyens et postes existants dans chaque académie, comme si la consigne était donnée de cacher le désastre. Ce n’est pas non plus le carré régalien académique, qui souffre des mêmes maux que la médecine préventive – affichage sans identification des personnes ressources – qui permettra de lutter contre les violences et harcèlements subis par les personnels.
Face à l’opacité qui règne pour accéder à la médecine préventive, mieux vaut bien connaitre son fonctionnement et vos droits en la matière. Notre fiche mémento résume l’ensemble des textes de référence qui les définissent et vous aidera à y voir plus clair.
II. Fiche mémento : tout savoir sur la médecine du travail et sur vos droits
Cette fiche a pour but d’éclairer l’organisation générale des missions de santé, de sécurité et de prévention aux ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Elle abordera plus particulièrement l’organisation du service de médecine préventive, les prérogatives du médecin du travail et les droits des agents.
1. Textes de référence :
– Article L 3 du Code général de la Fonction publique qui définit les fonctionnaires civils,
– Article L 911-1 du Code de l’Éducation qui assimile les corps de l’Éducation nationale à la Fonction publique d’État.
– Article L 811 – 1 du Code général de la Fonction publique instaurant une similarité de règles de prévention en matière de santé et de sécurité entre dans les services et établissements relevant de L3 et les travailleurs du privé (inclusion des contractuels), mais dérogation possible par décret en conseil d’État.
– Code du travail, Partie 4, livres I à V et articles R 4121-1 à R 4822-1 : les règles en matière de santé et de sécurité au travail.
– Article L 133-2 du Code général de la Fonction publique concernant la protection des personnes victimes de harcèlement ou dénonçant le harcèlement.
– Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique, pris en Conseil des ministres.
– Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, article 20.
– Articles L 4624-8 du code du travail, L 1110-4, L 1111-2 et R 1111-44 à R 1111-52 du code de santé publique, accès, conservation, conditions d’utilisation et clôture du dossier médical.
2. Organisation générale
• Il existe une Commission centrale d’hygiène et de sécurité au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État.
• Le ministre de la Fonction publique adresse un rapport annuel à cette Commission centrale d’hygiène et de sécurité.
• Globalement les règles en matière d’hygiène et de sécurité sont celles du Code du travail (livres I à V, partie 4 du Code du travail).
• Dans chaque administration déconcentrée de l’État (par exemple un rectorat), dans chaque administration centrale de ministère ou de plusieurs ministères réunis, ainsi que dans chaque établissement public de l’État ou de plusieurs établissements publics d’État réunis, il existe en matière de santé et de sécurité au travail :
1. un chef de service responsable chargé de la sécurité et de la protection des agents au travail,
2. une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) ou un Comité social d’administration (CSA),
3. des assistants de prévention et parfois (selon les risques de la profession ou l’effectif de celle-ci) des conseillers de prévention nommés par le chef de service. Le rôle des conseillers de prévention est celui de la coordination des assistants. Assistants et conseillers sont appelés agents de prévention.
Ces agents reçoivent une lettre de cadrage du chef de service. Leurs missions :
a) assistance au chef de service pour évaluer les risques,
b) proposer une politique de prévention,
c) assurer le suivi des registres de santé et de sécurité au travail (RSST),
d) participer à l’information, la sensibilisation, la formation des personnels en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail,
4. des inspecteurs de santé et sécurité au travail désignés par le ministre ou le directeur d’établissement public de l’Etat et rattachés aux inspections générales des ministères ou des établissement publics.
a) Ils reçoivent une lettre de mission.
b) Ils proposent au chef de service des mesures d’amélioration et se font présenter les registres réglementaires.
c) Ils peuvent recevoir le concours des inspecteurs du travail.
d) Ils peuvent demander l’aide d’un médecin inspecteur de la santé ou de la sécurité civile,
5. un service de médecine de prévention, animé et coordonné par un médecin du travail.
3. Le service de médecine préventive
• Organisation générale :
1. Le service est sous la responsabilité du chef de service chargé de la sécurité et de la protection des agents.
2. Il est animé et coordonné par un médecin du travail qui rédige un rapport annuel transmis au chef de service et à la FSSSCT.
3. Il comporte une équipe pluridisciplinaire appartenant soit au service créé par l’administration ou l’établissement public d’État, soit à une réunion de plusieurs de ces services, soit à une organisation à but non lucratif ayant un objet social de médecine du travail. L’indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l’administration est garantie dans le cadre d’une convention.
4. Cette équipe pluridisciplinaire comporte le médecin du travail, un infirmier en santé au travail ainsi que des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail en tant que de besoin et peut recevoir l’aide des services sociaux.
5. Le service possède un secrétariat, des locaux, le matériel nécessaire, fournis par l’administration.
Missions :
1. prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail,
2. conduire des actions de santé au travail pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel,
3. Organiser des visites d’information et de prévention tous les 5 ans auprès de tous les agents, réalisées par le médecin du travail ou le médecin collaborateur ou l’infirmier.
4. Médecin du travail : rôle et prérogatives
• Rôle :
1. Le médecin du travail reçoit une lettre de mission.
2. Il agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents.
3. Il n’est ni un médecin chargé des visites d’aptitude physique, ni un médecin de contrôle, cependant son action peut être complémentaire à celle du médecin chargé des visites d’aptitude physique lors de l’affectation d’un agent en ce qui concerne l’adaptation du poste à l’état de santé de l’agent.
4. Il fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit.
5. Il donne un avis sur les moyens nécessaires à attribuer au service de médecine de prévention.
6. Il est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.
7. Il met à jour périodiquement une fiche où sont consignés les risques professionnels propres à un service, la communique au chef de service qui l’annexe au document unique d’évaluation des risques socio-professionnels (DUERP), et la tient à disposition des inspecteurs de santé et sécurité, de la FSSSCT ou du CSA, de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur de la santé, du ministre, du directeur d’établissement, de l’inspecteur général du travail.
8. Il est consulté pour tout projet de construction ou d’aménagement important de bâtiment ou de modification des équipements.
9. Il est informé de l’utilisation de produit dangereux.
10. Il peut demander des prélèvements et mesures à fin d’analyses à l’administration qui peut refuser dans un avis motivé.
11. Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
12. Il doit passer au moins un tiers de son temps en milieu de travail, accompagné en cela par l’équipe pluridisciplinaire de médecine préventive selon le protocole écrit rédigé par lui-même.
• Prérogatives :
1. Il peut réaliser, prescrire ou recommander des examens complémentaires à un agent aux frais de l’employeur pour s’assurer de la compatibilité de l’agent à poste de travail, prévenir un risque épidémiologique ou une maladie professionnelle.
2. Il surveille particulièrement les agents en situation de handicap, les femmes enceintes, ayant accouché récemment ou allaitantes, les agents réintégrés après un congé longue maladie ou longue durée, ceux qui ont une pathologie particulière, ceux affectés dans un service présentant un risque.
3. Lui seul peut proposer des aménagements de poste ou de conditions d’exercice, en raison de l’âge, de la résistance physique ou de l’état de santé.
4. Lui seul peut proposer un aménagement temporaire de poste ou de conditions d’exercice à la femme enceinte, ayant accouché récemment ou allaitante.
L’administration peut refuser ces aménagements par un avis motivé transmis à la FSSSCT ou au CSA.
3. Droits et devoirs des agents
• La visite d’information et de prévention tous les 5 ans
– La visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole écrit.
– L’agent est informé au cours de cette visite qu’il peut bénéficier à tout moment d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif.
– L’agent reçu par un médecin collaborateur peut être orienté sans délai vers le médecin du travail.
– L’agent fournit à son administration la preuve qu’il a satisfait à l’obligation de visite médicale tous les cinq ans.
• La visite libre de l’agent
Il peut bénéficier à tout moment d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif.
• La visite à l’initiative de l’administration
L’administration peut demander au médecin du travail de recevoir l’agent, elle doit informer ce dernier de sa démarche.
• Droit de contestation
L’agent peut contester un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail auprès du chef de service qui saisit l’inspecteur du travail territorialement compétent.
• Droit à une autorisation d’absence
Des autorisations d’absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire. Cela concerne également les examens prescrits ou recommandés par le médecin du travail.
Vous avez des questions, besoin d’être accompagné ? N’hésitez pas à nous contacter : communication@sncl.fr