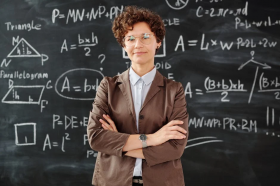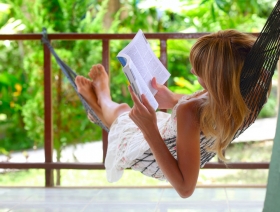Le nouveau gouvernement amène à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de celui de l’Education nationale deux nouveau noms, relativement inconnus du grand public mais qui connaissent pourtant bien l’institution. Quels portraits dresser de ces deux hommes, et qu’attendre d’eux concernant les grands chantiers laissés en suspens ?
Philippe Baptiste : la continuité des chantiers dans un contexte budgétaire tendu
Un peu moins d’un an après sa première nomination au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste retrouve le chemin d’un gouvernement, cette fois avec un portefeuille complet et élargi à l’Espace. Ce retour s’inscrit dans la continuité de son action précédente, marquée par la volonté de moderniser la gouvernance universitaire et de réguler le secteur privé lucratif, sans rompre avec les grands équilibres de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR).
Un profil de chercheur et de stratège
Né en 1972, ingénieur des Mines, docteur en informatique et ancien directeur scientifique du CNRS puis de Total, Philippe Baptiste incarne le profil du scientifique devenu administrateur, étant passé par le cabinet de Frédérique Vidal, puis par la présidence du CNES (Centre National d’Étude Spatiale). Son agenda au MESR s’annonce très dense :
• Budget 2026 : maintenir le financement des universités et des mesures RH de la LPR malgré les économies exigées.
• Réforme de la formation des enseignants : achever la refonte du master MEEF et sécuriser la rémunération des étudiants en préprofessionnalisation — un sujet suivi de près par le SNCL et la FAEN.
• Projet de loi sur l’enseignement supérieur privé : déposé au Parlement à l’été 2025, il vise à mieux encadrer un secteur en expansion, tout en prolongeant certaines expérimentations du public (EPE, accréditations globales…).
• Simplification administrative et autonomie : Philippe Baptiste entend poursuivre la « déconcentration » de la gestion vers les rectorats et renforcer l’autonomie des établissements, à condition que celle-ci s’accompagne d’une réelle stabilité des moyens.
Des incertitudes persistantes
Les inquiétudes demeurent fortes autour du financement de l’apprentissage, de la réforme des bourses étudiantes — gelée faute de budget — et du sort du HCERES, dont la suppression ou le maintien n’est toujours pas tranché. Pour le SNCL, ces dossiers traduisent un risque croissant de déséquilibre entre universités bien dotées et établissements plus fragiles, ainsi qu’une tendance à la responsabilisation locale sans moyens pérennes.
Édouard Geffray : la rigueur du haut fonctionnaire face à l’urgence éducative
Nommé le 12 octobre 2025, Édouard Geffray prend la tête d’un ministère de l’Éducation nationale secoué par une instabilité chronique — sept ministres en trois ans — et confronté à des défis multiples : baisse démographique, perte d’attractivité des métiers, crise du sens et montée des tensions dans les établissements. Ancien Directeur Général de l’Enseignement Scolaire (Dgesco) puis DGRH du ministère, il connaît parfaitement la « machine Éducation nationale ».
Un parcours typique de la haute administration
Né en 1978, diplômé de Sciences Po et de l’ENA (promotion Romain Gary), Édouard Geffray a construit sa carrière entre le Conseil d’État et les structures centrales du ministère. Ancien secrétaire général de la CNIL (2012-2017), il a aussi été directeur de cabinet de François Bayrou au ministère de la Justice avant de devenir DGRH (2017-2019), puis Dgesco (2019-2024). Sa nomination incarne la continuité administrative d’un système qu’il connaît dans ses moindres rouages, mais aussi peut-être la promesse d’une approche plus technique et d’une méthode plus posée après des années de réformes successives.
Trois priorités annoncées
Lors de sa première intervention sur France Inter, le 22 octobre, Édouard Geffray a défini trois axes d’action :
– La qualité pédagogique de l’enseignement public, à travers une montée en puissance de la formation continue et une exigence renforcée sur la formation initiale ;
– La lutte contre la très grande difficulté scolaire, concentrée dans 15 % des collèges ;
– La sécurité physique et psychique des élèves et des personnels, avec la création de postes d’infirmières, de psychologues et d’assistantes sociales, dans le contexte d’abandon de la médecine scolaire et professionnelle que nous connaissons.
Une approche budgétaire prudente
Le ministre assume un budget « contraint », tout en soulignant que les suppressions de postes d’enseignants (4 000 prévues au PLF 2026) sont « inférieures à ce qu’imposerait la démographie ». Il met en avant la baisse historique du nombre d’élèves par classe dans le premier degré (21 élèves en moyenne), tout en reconnaissant les limites du modèle : attractivité insuffisante des métiers, pénurie d’AESH, postes non pourvus. Il dit vouloir « augmenter les promotions » pour relancer la dynamique de carrière, conscient du « plateau de rémunération en milieu de parcours ». Une annonce qui va dans le sens de nos analyses mais dont la portée réelle dépendra du vote budgétaire.
Des chantiers structurants
Plusieurs dossiers lourds attendent Édouard Geffray :
• Formation des enseignants : pilotage du déploiement de la réforme, carte des formations, effectifs ouverts aux concours 2026.
• École inclusive : avenir des pôles d’appui à la scolarité (PAS) et meilleure reconnaissance des AESH.
• Sécurité scolaire : relance du plan « Tous unis contre les violences » et appui au projet de loi pour la protection des personnels.
• Rythmes scolaires et santé mentale : réflexion issue de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant et poursuite du plan Santé mentale.
Un ministre du dialogue ?
Critiqué pour sa proximité avec l’administration centrale, Édouard Geffray se présente comme un partisan du dialogue social. « J’ai d’excellentes relations avec les syndicats », a-t-il déjà déclaré, rappelant ses sept années de direction sous cinq ministres successifs. Reste à voir si cette méthode de concertation s’accompagnera d’une écoute réelle des personnels de terrain et d’un rétablissement du dialogue social, conditions essentielles pour restaurer la confiance.
Deux ministres, deux profils, une même attente : redonner confiance aux acteurs de l’Éducation
Les nominations de Philippe Baptiste et Édouard Geffray traduisent la volonté du gouvernement de miser sur des profils expérimentés, rompus à la gestion administrative et à la continuité de l’État. Mais cette continuité, si elle rassure les institutions, ne suffira pas à restaurer la motivation des personnels confrontés à l’usure, à la complexité bureaucratique et à la stagnation salariale. Par ailleurs, malgré le retour de deux ministères séparés, les deux ministres devront coopérer étroitement, notamment sur le terrain de la formation initiale et continue. La réussite de la réforme du master MEEF dépend à la fois des moyens budgétaires du MESR et des besoins exprimés par l’Éducation nationale. Le SNCL rappelle son attachement à une formation cohérente, exigeante et statutairement protégée, pour garantir la qualité du service public et la reconnaissance du métier d’enseignant.
Notre syndicat veillera à ce que les belles paroles sur les promotions, les carrières et la revalorisation débouchent sur des mesures concrètes et non de simples ajustements techniques. Les personnels attendent un signal fort : celui d’un ministère qui reconnaît leur engagement quotidien, au-delà des discours. Une demande d’audience a d’ores et déjà été adressée par le SNCL, avec au programme certains points techniques sur lesquels nous pensons pouvoir enfin avancer, après des mois de simulacre de direction à la tête de notre ministère.
Les personnels de l’Éducation nationale n’ont pour leur part plus le luxe d’attendre. Au-delà des profils de ces deux ministres, c’est la capacité du gouvernement à donner du sens, du temps et des moyens à l’École et à l’Université qui fera la différence.