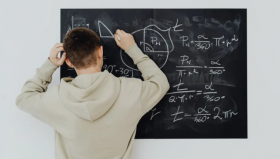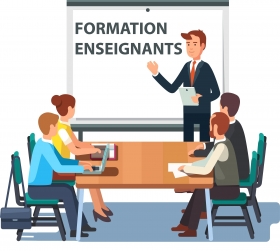Et voilà : il a suffi de quelques déclarations médiatiques et d’une fuite de documents pour que la réforme de la formation des enseignants soit à nouveau sur le tapis. Si elle aboutit, elle sera tout de même la 4ème réforme de ce type depuis 2010, et la deuxième sous Emmanuel Macron. En effet, alors que la réforme Blanquer (qui ne sera pas regrettée) avait créé les Inspé et placé le concours de recrutement en fin de Master 2 en 2019, le gouvernement revoit déjà sa copie.
Evoquée par Emmanuel Macron dès sa réélection en 2022, puis annoncée par Gabriel Attal à l’automne dernier, il aura fallu attendre la fuite d’un document de travail du Ministère de l’Education Nationale fin mars pour avoir des précisions sur le contenu de l’ensemble. Le projet qui y était esquissé a finalement été rendu officiel par l’annonce d’Emmanuel Macron le 5 avril 2024 lors d’un déplacement dans l’école primaire Blanche à Paris.
Premier constat : un copié-collé de nos revendications !
En premier lieu, on ne peut que regretter l’absence totale de concertation avec les organisations représentatives des personnels durant toute la phase d’élaboration de ce projet, et dénoncer le degré de mépris des personnels qui se dédient à cette formation et qui, eux n’ont plus, n’ont pas vu passer l’ombre d’une consultation sur le sujet. Mais il y a au moins une bonne surprise à la lecture des premières lignes directrice : il s’agit quasiment mot pour mot de la direction que porte le SNCL dans ses motions depuis plusieurs années.
La grande nouveauté de cette réforme consisterait en effet à refondre le concours de recrutement et à l’avancer dès l’année de L3, pour les futurs enseignants du premier comme du second degré. Les lauréats poursuivront ensuite en Master pendant deux années en tant qu’« élèves fonctionnaires », au cours desquelles ils seront rémunérés et alterneront enseignements et stages d’observation ou mise en responsabilité.
Or cette proposition est extrêmement proche de nos revendications réaffirmées lors de notre congrès national de juin 2023, dont il vaut la peine que nous citions un extrait tant les similitudes sont frappantes jusque dans le vocabulaire choisi :
« Le SNCL considère que la meilleure solution réside dans le passage du concours après la licence […].Ensuite, deux années de formation professionnelle, rémunérées de façon attractive et prises en compte pour le calcul de la pension avec le statut d’élève-professeur déboucheraient sur l’attribution du master.
Pour garantir une meilleure qualité de formation, l’alternance entre l’établissement d’exercice et l’INSPÉ doit être régulière dans le but de lier plus intimement les formations pratique et théorique.
Il est indispensable d’adapter régulièrement les concours et leurs contenus à l’évolution des métiers de l’enseignement afin d’éviter les décalages entre ce qui est demandé et la réalité du terrain.
Pour le SNCL il est primordial que les stages se multiplient progressivement tout au long du cursus universitaire et de la préprofessionnalisation. »
Le SNCL a donc commencé par se réjouir de voir ses motions ainsi traduites en projet de réforme et ne peut qu’espérer que cette nouvelle mouture de la formation initiale sera enfin la bonne, ou à tout le moins plus pérenne que les précédentes.
L’un des principaux avantages du nouveau programme de formation serait de rendre l’entrée dans le métier beaucoup plus attractive pour les jeunes enseignants. Emmanuel Macron a en effet déclaré vouloir « élever le niveau qualitatif de la formation des enseignants, mieux préparer les futurs professeurs à l’exercice de leur métier, renforcer l’attractivité du métier et répondre à la crise de recrutement ». Une ambition qu’il est difficile de ne pas partager. Mais le Président a-t-il les moyens de ses ambitions ?
Il faut être clair sur un point : ces deux années de Master rémunérées doivent offrir un salaire décent, et permettre de valider 4 trimestres par année civile pour les droits à pension. Pour le SNCL, c’est un enjeu d’autant plus crucial depuis la réforme des retraites : ce serait pour les professeurs le seul moyen d’obtenir un départ à la retraite à 64 ans et à taux plein après une carrière complète. Notre syndicat sera donc particulièrement intransigeant à ce sujet car le diable se cache souvent dans les détails…
Que prévoit la réforme dans le détail ?
C’est probablement là que les difficultés commencent, car malheureusement, passées les grandes lignes directrices, le projet semble vite sonner très creux et l’on voit avant tout l’administration s’adonner à son exercice préféré de remplissage et de langue de bois. Ainsi, difficile d’imaginer une réforme de la formation des enseignants sans que le ministère ne s’offre le plaisir cosmétique de changer de nom la structure qui s’en charge… Après les Ecoles normales, après les IUFM, après les ESPE puis les fulgurants INSPE, réservons un tonnerre d’applaudissements pour… les ENSP ! Les Ecoles normales supérieures du professorat – il fallait y penser -, aussi appelées « Ecoles normales du 21ème siècle » dans le jargon ministériel. Au moins la boucle semble-t-elle être bouclée, et peut-être nos instituts de formation cesseront-ils désormais de changer de noms tous les cinq ans ?
Au-delà du nom cependant, d’autres directions nouvelles s’annoncent plus inquiétantes. Dans son document de travail, le ministère tend à renforcer sa mainmise sur la direction de ces établissements et le contenu des formations. Il affirme ainsi qu’une « large place sera donnée aux tutelles (MENJ et MESR) pour l’assurance qualité », et veut instaurer « un référentiel de compétences décliné en maquettes nationales avec un degré de granularité très fin ».
Des propos cavaliers complètement contraires à la philosophie originelle des instituts de formations. France Université a d’ailleurs réagi dans un communiqué pour mettre en garde contre une « désuniversitarisation » (sic) de la formation des enseignants :
« s’il est légitime que l’employeur définisse les compétences attendues des futurs professeurs, il ne doit pas se substituer aux opérateurs. Il revient au HCERES d’évaluer ces parcours de licence et master, et aux universités de prendre en compte ces évaluations et les attentes de l’employeur, mais il ne saurait être question d’une formation seulement hébergée dans les locaux de l’université. […] la formation des enseignants est une compétence que le législateur a confiée de longue date à l’université, et elle doit le rester, à l’instar de ce qui se fait partout dans le monde, là où l’École se porte bien ».
Le SNCL partage cette préoccupation et demande à ce que le gouvernement garantisse la prérogative de l’université à définir de manière autonome le contenu des formations des enseignants.
Et cette autonomie, pour être garantie, doit en outre s’appuyer sur des délais de mise en oeuvre raisonnable… or c’est tout le contraire qui se profile.
Des modifications majeures dans le premier degré
Le premier degré est majoritairement concerné par les nouveautés de cette réforme. D’abord, une licence spécifique serait créée dans les universités pour les étudiants se destinant à devenir professeur des écoles : une « licence mention préparation au professorat des écoles (LPPE) ». A l’heure actuelle en effet, la plupart des aspirants suivent une licence de français ou encore de mathématiques, ou bien une « licence préparatoire au professorat des écoles » mais qui est pilotée par l’une de ces composantes. Dorénavant, la LPPE sera pilotée directement au sein des nouvelles ENSP.
Ce programme de licence serait découpé ainsi :
– « 50 % académique : français, mathématiques, sciences, langues vivantes, histoire-géographie, Arts, EPS
– 30 % pédagogique : valeurs de la République, didactique des disciplines, pédagogie générale
– 20 % terrain : stage + connaissance du système éducatif, élèves à besoins particuliers, exploitation du stage ».
Ce projet prévoit que les enseignants au sein de ce cycle préparatoire seront :
– « à 50 % des professeurs du MENJ : 30 % choisis et mis à disposition du cycle préparatoire pour trois ans renouvelables une fois (intégration à un ‘cursus honorum’ : professeurs des écoles expérimentés, professeurs du second degré repérés) et 20 % choisis pour les stages et les spécialisations ‘terrain’,
– à 50 % des enseignants de l’université ».
Par ailleurs, suivre cette licence spécifique permettra aux étudiants d’être dispensés des épreuves écrites d’admissibilité du CRPE (passé désormais en fin de L3). En fin de L1 et de L2, les étudiants passeraient à la place des « tests normalisés conçus par le MENJ », en plus de leurs examens de licence.
Le SNCL met toutefois en garde contre le risque de décourager les candidats au CRPE venus d’autres licences, qui constituent à l’heure actuelle un vivier important. Le ministère assure que des passerelles existeront toujours, avec notamment un « module de préparation au concours (60 ECTS/an, axés pédagogie, didactique, terrain) » offert en complément d’une licence disciplinaire, et dispensé par des enseignants de l’ENSP.
Les concours de recrutement à Bac+3, avec quelles modifications ?
Si le ministère promet des concours « rénovés, simplifiés », le format des épreuves semble pour autant rester identique, à savoir deux épreuves écrites d’admissibilité, suivies de deux épreuves orales d’admission. Les intitulés de chaque épreuve semblent reprendre l’esprit de leur prédécesseur, avec toutefois quelques nuances.
Pour le premier degré, les épreuves seraient :
– deux épreuves d’admissibilité écrites (desquelles seraient dispensés les étudiants ayant suivi la LPPE) : « vérification de la maîtrise des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques » ; « vérification des connaissances dans les autres disciplines »
– deux épreuves d’admission orales : « évaluation de la capacité d’expression et de réflexion grâce à un exposé disciplinaire (maths ou français) et un échange » ; « appréciation de la motivation, de la capacité à se projeter dans le métier enseignant et à transmettre et incarner les valeurs de la République ».
Pour le second degré :
– deux épreuves d’admissibilité écrites : « vérification des connaissances disciplinaires » ; « appréciation de la capacité d’analyse sur les compétences disciplinaires spécifiques sur la base de supports »
– deux épreuves d’admission orales : « évaluation de la capacité d’expression et de réflexion grâce à un exposé disciplinaire et un échange » ; « appréciation de la motivation, de la capacité à se projeter dans le métier enseignant et à transmettre et incarner les valeurs de la République ».
Le SNCL s’étonne toutefois qu’il n’est plus question d’évaluer les compétences « didactiques » ni « pédagogiques » des candidats. Si l’on peut concevoir qu’un concours avancé en L3 ne permette pas d’évaluer autant de compétences qu’auparavant, il s’agit d’un revirement philosophique plutôt brutal, alors que depuis de nombreuses années la tendance était au contraire au renforcement des évaluations de ces aspects du métier.
Une refonte du Master
Après réussite du concours, les lauréats du premier degré comme du second seront admis en ENSP pour leur Master, « sous statut de la fonction publique et reçoivent une formation de deux ans avec prise de fonction sur le terrain selon une progressivité renforcée ».
La rémunération s’élèverait au salaire minimum en M1 soit environ 1 400 € nets par mois, et au salaire actuel des stagiaires en M2, soit environ 1 800 € nets par mois. Cependant, des rumeurs circulent déjà sur une rémunération plus faible encore en M1, ce que le SNCL considérerait comme inacceptable pour des lauréats d’un concours de la fonction publique. Par ailleurs, nous attendons du ministère l’engagement que ces années de travail seront pleinement comptabilisées pour la validation de 4 trimestres par année civile pour les droits à pension, et qu’elles seront également prises en compte pour l’avancée dans les échelons à l’entrée dans le corps d’appartenance.
Côté formateur, les enseignants devraient être à 50 % des professeurs du MENJ et à 50 % des enseignants de l’université. L’accent serait mis sur « la pratique professionnelle » et « la mise en responsabilité ».
La maquette de formation serait la suivante :
En M1 :
– 37,5 % (1,5 jour par semaine) de temps dédié à la mise en application sur le terrain, en stage d’observation et de pratique accompagnée
– 25 % de pratique et enseignements professionnels
– 37,5 % d’approfondissements universitaires disciplinaires et optionnels.
En M2 :
– 50 % (2,5 jours par semaine) de temps dédié à la mise en responsabilité avec un mémoire sur la pratique
– 20 % de pratique et enseignements professionnels
– 30 % d’approfondissements universitaires disciplinaires et optionnels.
Les étudiants seront enfin titularisés à bac+5 en cas d’obtention du master ENSP et suite à un « avis sur les périodes de stages d’observation et pratique accompagnée (SOPA) et de mise en responsabilité ».
Un calendrier une fois de plus précipité
Réforme des parcours, réforme des épreuves, refonte des équipes, que de projets… mais dans quels délais le ministère ambitionne-t-il de mettre tout cela en place ? Un délai probablement réaliste serait une amorce des changements sur l’année scolaire 2024-2025, pour une bascule progressive entre 2025 et 2027, pour espérer une mise en place complète du dispositif à partir de 2028-2029.
Le calendrier envisagé, hélas, n’est pas celui-ci, et se révèle au contraire sidérant de naïveté : le ministère espère en effet que tout ceci sera opérationnel… dès la rentrée prochaine !
Cette folie (mais qui n’a toutefois pas encore été confirmée) suivrait le rythme suivant :
-
mai 2024 : publication du programme du concours niveau Licence 2025 (version transitoire avant la montée en puissance complète du cycle préparatoire aux ENSP), soit dans quelques jours seulement !
-
septembre 2024 : début des modules complémentaires permettant aux étudiants en L3 de préparer le nouveau concours 2025 (ce qui suppose des inscriptions ouvertes dès le mois prochain ? et des cours prêts parachevés par les formateurs cet été ??)
-
juin 2025 : premier concours niveau Licence (version transitoire) + concours niveau Master (maintenu provisoirement pour les étudiants de l’ancien système qui seront en M2) ; création des mentions de master ENSP
-
septembre 2025 : première rentrée dans les ENSP (M1) ; ouverture des L1 PPE et des L2 PPE pour permettre un recrutement dès 2026 puis en 2027 sur la base du concours niveau Licence version stabilisée
-
juin 2026 : concours niveau Licence version stabilisée
-
septembre 2026 : ouverture des L3 PPE ; mise en place d’un comité d’accréditation MENJ-MESR
-
2027 : fin de la période transitoire.
A l’image de l’instauration en catimini des groupes de niveau au collège, ce calendrier au pas de charge est une fois de plus éminemment problématique. D’abord, parce que la refonte d’une formation universitaire est une tâche complexe qui ne s’improvise pas en quelques mois. Comment créer dès septembre un module de formation au nouveau concours en L3 alors que le programme du concours devrait être publié (dans le meilleur des cas) en mai ? Cette précipitation génèrera stress et surmenage aussi bien pour les formateurs que pour les candidats. Elle cristallise le manque total de considération pour les équipes et leur travail.
Ensuite, ce calendrier est intenable parce qu’il reste encore beaucoup d’incertitudes sur le contenu effectif de cette réforme. La plupart des informations dont nous disposons à l’heure actuelle ne viennent que d’un document de travail. Le ministère a reconnu lui-même que beaucoup d’arbitrages n’étaient pas rendus et qu’il fallait en passer par la concertation avec les organisations syndicales. Comment faire croire à une réelle volonté de concertation, avec des délais aussi serrés, lorsqu’on prétend publier de nouveaux programmes avant même d’avoir fixé une date de rencontre syndicale pour discuter du fond de la réforme ?
Le SNCL déplore cette précipitation et ce simulacre de dialogue social qui risquent bien de tuer dans l’oeuf le projet et d’enterrer avec lui l’opportunité de tourner le dos à la réforme Blanquer.
Il se félicite néanmoins du fait que cette réforme porte la marque de plusieurs de ses revendications et considère qu’elle va dans le bon sens pour la formation de nos futurs collègues et pour l’attractivité du métier. De nombreux éléments doivent être impérativement précisés, et le SNCL exige un moratoire d’un an minimum avant la mise en oeuvre des premiers changements. Notre syndicat défendra vigoureusement ses convictions, notamment pour la prise en compte effective des années de travail en Master dans la cotisation au système de retraite.