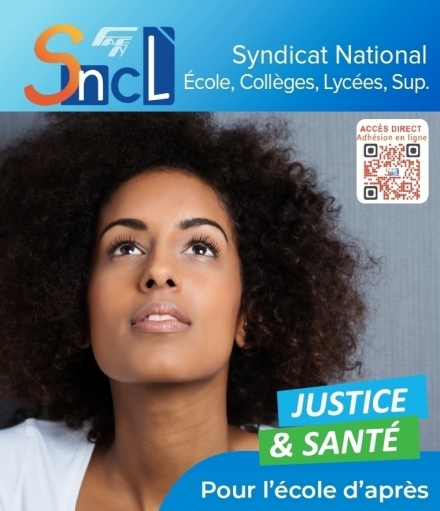|
Adresse aux députés
Objet : réforme des retraites
Mesdames et messieurs les Députés,
Le Conseil des ministres du 24 janvier a validé deux projets de lois visant à créer un « régime universel » de retraite.
Vous serez amenés à examiner prochainement cette loi qui va bouleverser la vie de tous vos concitoyens pour les décennies à venir, dans leur quotidien le plus concret, et tout particulièrement à cette période très sensible de leur existence qui fait suite à leur vie active et expose chacune et chacun plus fortement aux risques d’isolement, de dépendance et de maladie.
Vous êtes un représentant de la Nation et avez probablement d’ores et déjà conscience que les retraités participent activement à la solidarité entre les générations ainsi qu’à l’économie nationale dans son ensemble. La question des retraites ne saurait être posée uniquement en termes budgétaires, mais il est aussi important de se souvenir que toute diminution des pensions aurait un impact négatif inévitable sur la consommation et donc sur toute l’économie de notre pays.
Le gouvernement justifie son projet de réforme par une recherche d’équité. Or, ce projet entraînera une baisse du montant des retraites, une hausse des cotisations et un allongement de la période d’activité pour une majorité des Français.
DES RÉFÉRENTS SOCIAUX SACRIFIÉS
Regroupant des personnels de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, le SNCL, le SAGES et le SIES et leurs adhérents sont très attachés au statut général de la Fonction publique et son prolongement naturel, le Code des pensions civiles et militaires.
La carrière des fonctionnaires est historiquement différente de celles des salariés des entreprises des secteurs industriel et commercial ainsi que de celles des professions libérales.
Les salaires y sont inférieurs, à niveau de recrutement équivalent, à ceux de ces professions ; leur progression est continue mais lente. Lors de leur cessation d’activité ils ne perçoivent pas une retraite payée par les cotisations des actifs mais une pension qui est un salaire différé, payé directement par le budget de l’Etat.
Prolongement du salaire et compensation de leur faible rémunération, notamment de début de carrière, la pension des fonctionnaires est logiquement calculée sur la base du traitement reçu pendant une courte période précédant la cessation d’activité (6 derniers mois).
Selon la Cour des comptes (2016), le régime de pensions donne des « taux de remplacement » (différence entre le dernier revenu d’activité et la retraite) pour les agents publics équivalents à ceux des salariés malgré des règles différentes.
En créant un régime universel, le gouvernement s’apprête à faire voler cela en éclat. Le Code des pensions civiles et militaires serait supprimé, et avec lui toutes les garanties qu’il contient. Les fonctionnaires quitteraient le système des pensions pour rejoindre l’assurance vieillesse.
Par ailleurs, les Français sont attachés à la retraite par répartition. Or, en fondant son projet de réforme sur une retraite par points, caractéristique des retraites par capitalisation, le gouvernement introduit un ver dans le fruit. Et s’il conserve le paiement des retraites par les cotisations versées au même moment, c’est qu’il ne peut faire autrement.
LES PRINCIPALES MOTIVATIONS DU GOUVERNEMENT
Il s’agit d’abord de réduire la masse financière consacrée aux retraites et d’en faire une variable d’ajustement des fluctuations économiques.
Le gouvernement veut également procurer de substantielles économies au budget de l’Etat qui consacre 74,28 % des traitements indiciaires de base pour financer les retraites des fonctionnaires de l’Etat.
En basculant dans le régime d’assurance vieillesse par points, l’Etat deviendrait un employeur comme les autres. Son financement passerait alors progressivement, en 15 ans, de 74,28 % à 16,87 %, soit une économie cumulée de 150 milliards d’euros sur cette période, selon les estimations de Médiapart. C’est donc bien un désengagement sans précédent de l’Etat qui se cache derrière une volonté de prétendue équité.
Parce que nous sommes aussi des contribuables, nous pourrions nous réjouir de ces économies, mais nous savons que les sommes qui ne seront plus payées par le budget de l’Etat devront l’être par les cotisations des salariés, des fonctionnaires et des entreprises.
QUELQUES POINTS POSITIFS
Le projet du gouvernement comporte quelques mesures positives comme l’augmentation des retraites des agriculteurs, la possibilité de continuer à cotiser pour améliorer sa propre retraite pour les pensionnés à faible retraite contraints de poursuivre une activité rémunérée.
L’indexation des pensions sur le salaire moyen est aussi statistiquement une avancée de même que la garantie d’une retraite minimum à 1 000 euros, mais elle est conditionnée à la revalorisation d’une carrière complète ce qui sera de moins en moins souvent le cas.
Tous ces éléments seraient importants pour ceux qui pourraient en bénéficier. Mais ils ne sont pas liés à l’instauration d’un système universel par points ; ils peuvent également être pris dans le cadre du système de retraites actuellement en vigueur.
En fait, ces annonces de faible ampleur s’appliquent à un nombre limité de Français. Elles servent d’alibi au gouvernement qui, pour gagner la bataille de l’opinion, veut donner une touche sociale à un projet qui ne l’est pas.
DE GRAVES CONSÉQUENCES
L’abandon du calcul de la pension des fonctionnaires sur la base du salaire des six derniers mois entraînerait à terme une forte diminution des pensions devenues retraites de certains fonctionnaires et une augmentation sensible des cotisations de certains autres.
La prise en compte des primes pour l’acquisition des points ne compenserait qu’à la marge la baisse des retraites de ceux qui en perçoivent peu comme les enseignants et les personnels administratifs de l’Education nationale des catégories B et surtout C.
Sur la base des données chiffrées contenues dans le rapport Delevoye et les documents du COR, nos syndicats ont calculé la baisse du montant de la retraite d’un professeur qui cotiserait pendant toute sa carrière au régime universel par points et partirait à la retraite à 62 ans par rapport à la pension du même professeur partant aujourd’hui au même âge avec un salaire moyen des six derniers mois de 3 000 € bruts. La baisse serait de 514 € par mois, soit 23 % de perte sur sa pension alors même que ses cotisations augmenteraient de 6,7 % !
L’ampleur de cette baisse est telle que, d’abord incrédules, nous l’avons recalculée plusieurs fois.
Cette baisse est d’ailleurs corroborée par un groupe d’économistes qui, eux, communiquent sur une baisse encore plus forte (26 %).
Nous avons ensuite calculé que pour obtenir un niveau de retraite équivalant au montant de la pension d’aujourd’hui, le professeur cotisant au régime universel devrait acquérir 934 points supplémentaires, ce qui nécessiterait une augmentation de salaire de 83 022 euros sur l’ensemble de sa carrière, soit une augmentation de 168 euros par mois sur les 492 mois de ses 41 ans de carrière.
Le 24 janvier dernier le gouvernement publiait, dans une « étude d’impact » des estimations minorant sensiblement la baisse des pensions des professeurs, sans préciser son mode de calcul.
Le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Education nationale ont été obligés de reconnaître le problème flagrant touchant les enseignants et de promettre une « revalorisation » d’un montant cumulé sur quinze ans de 10 milliards d’euros pour le million de professeurs de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur. Cela représente 55 € mensuels en moyenne pour chacun. Nous sommes donc loin du compte !
Espérant faire de deux problèmes une solution, le ministre a également osé annoncer que cette « revalorisation » ne serait accordée qu’en contrepartie d’aggravations des conditions de travail des personnels.
Une démarche d’autant plus choquante si l’on compare ces 10 milliards d’euros aux 150 économisés par l’Etat sur la même période, comme mentionné plus haut.
QUELLE CONFIANCE PEUT-ON ACCORDER AUX PROMESSES DU GOUVERNEMENT ?
Le SNCL, le SAGES et le SIES sont indignés par le flou entretenu à de nombreux niveaux autour des conséquences précises des principes contenus dans les projets de lois.
La cohésion sociale ne se décrète pas. Elle ne s’obtient pas davantage par la succession de coups de com et de buzz médiatiques. Elle se construit dans la durée en instaurant la confiance, en entraînant l’adhésion du plus grand nombre à des objectifs clairement identifiés et partagés.
Les grèves et manifestations qui se succèdent à un rythme intense dans le pays depuis le 5 décembre dernier démontrent que ces projets sont rejetés et combattus par une majorité de salariés dont les actions sont soutenues par une majorité de Français malgré la gêne qu’elles entraînent.
En choisissant le pourrissement, le gouvernement installe la défiance, oppose les Français entre eux et distend le tissu social.
Comment avoir confiance quand on sait que nous ne connaîtrions toutes les conséquences de ces lois que bien après leur promulgation, lors de la publication ultérieure des 29 ordonnances et des nombreux autres textes d’application prévus ?
L’avis inhabituellement sévère donné par le Conseil d’Etat n’est pas de nature à nous rassurer. Il précise « cette situation est d’autant plus regrettable que les projets de loi procèdent à une réforme du système de retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue l’une des composantes majeures du contrat social».
La méthode d’ensemble utilisée par le gouvernement est inacceptable.
Le Conseil d’Etat indique également que les délais très courts d’examen qui lui ont été imposés ne lui permettent pas d’assurer la « sécurité juridique » du dispositif. Des recours ont donc des chances d’aboutir.
Il estime ensuite que « les documents d’impact doivent répondre aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des travaux » laissant entendre que ceux transmis ne le sont pas puisque les projections financières sont « lacunaires », dire peu fiables. Des mesures encore plus coercitives pourraient donc être ultérieurement prises si la réalité s’avérait moins favorable que les prévisions.
Et ce n’est pas tout : le Conseil d’Etat signale que le fait de faire dépendre d’une autre loi la programmation sur 15 ans prévue pour une revalorisation des enseignants, dans le premier article du projet de loi portant réforme des retraites, est inconstitutionnel. Un vrai marché de dupes.
Pour toutes ces raisons et d’autres que nous renonçons à développer pour ne pas abuser de votre temps, le SNCL, le SAGES et le SIES demandent à chaque parlementaire de rejeter les deux projets de lois qui sont présentés par le gouvernement.