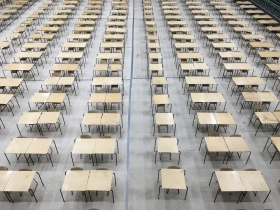À l’occasion de cette rentrée scolaire, la question du bien-être mental à l’école revient avec force (la santé mentale en général ayant été déclarée grande cause nationale 2025). Elle concerne à la fois les élèves – dès la maternelle – et les enseignants, de plus en plus exposés à une charge émotionnelle et professionnelle accrue.
Des données inédites chez les enfants de 3 à 11 ans
L’étude nationale Enabee, pilotée par Santé publique France et actualisée au printemps dernier, offre un état des lieux inédit de la santé mentale des plus jeunes en France.
Lancée en 2022, elle visait à combler un manque criant de données sur le bien-être des enfants de moins de 11 ans. Jusqu’alors, la plupart des dispositifs de surveillance concernaient les adolescents (EnCLASS, i-Share…) mais en interrogeant les enfants eux-mêmes (à partir du CP), leurs parents et leurs enseignants, l’étude permet d’obtenir une vision plus fine de leur état psychologique. Les résultats en sont préoccupants :
• 13 % des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale (troubles émotionnels, oppositionnels, TDAH…).
• Chez les 3-6 ans, ils sont 8,3 % à souffrir de difficultés probables ayant un impact sur leur vie quotidienne.
Ces taux rappellent que les problèmes de santé mentale apparaissent tôt et peuvent peser durablement sur la scolarité, la socialisation et le développement global de l’enfant.
L’école, témoin et relais des fragilités
Même si Enabee n’est pas centrée sur le climat scolaire, l’institution scolaire est directement concernée. Les enseignants, souvent en première ligne, observent les signaux faibles : isolement, agitation, rebellion, phobies scolaires, difficultés de concentration. Le questionnaire qui leur était adressé dans le cadre de l’étude confirme leur rôle-clé dans le repérage des fragilités.
Or, ces derniers font eux-mêmes face à une mise en danger de leur propre santé mentale. Entre surcharge administrative, manque de moyens, tensions liées à l’inclusion scolaire ou aux attentes des familles, nous ne cessons de constater une dégradation forte : hausse des burn-out, des conflits hiérarchiques et de la maltraitance institutionnelle à l’encontre de collègues impactés psychologiquement… Les représentants syndicaux se retrouvent dans une position de confidents, dépositaires de témoignages de plus en plus difficiles. Ainsi, les difficultés des enfants et celles des adultes qui les encadrent s’entremêlent, créant un cercle potentiellement délétère.
Une crise révélée par la pandémie
Il est incontestable que la crise du COVID-19 a joué un rôle d’accélérateur à ce niveau : isolements répétés, inquiétudes sanitaires, pertes de repères scolaires ont profondément affecté enfants et adultes. Déjà, Santé publique France constatait une augmentation des passages aux urgences pour motifs psychologiques chez les jeunes après 2020.
Mais ces problématiques n’ont pas encore eu le temps d’être bien analysées et comprises, que déjà de nouveaux problèmes ce sont ajoutés : surexposition des jeunes aux écrans, cyberharcèlement, désinvestissement parental, influence des réseaux sociaux et des fake news sur la pensée des adolescents… le feu prend de toutes parts et notre école se retrouve cernée par l’incendie.
Et maintenant ?
L’ambition des enquêtes comme Enabee est de bâtir une source de données fiables à travers le temps, permettant de suivre l’évolution du bien-être des enfants d’année en année. Elle s’inscrit dans un cadre plus large : développement des compétences psychosociales dès la petite enfance, campagnes de prévention et stratégies de santé mentale inscrites au niveau national (journée nationale de lutte contre le suicide, etc.).
Mais les chiffres ont peu d’intérêt s’ils ne sont pas suivis d’effet : la médecine scolaire et l’accompagnement psychologique des plus jeunes doivent être repensés, ce qui ne peut se faire à moyens constants, ni en faisant porter cette mission supplémentaire sur les épaules des professeurs : c’est ce que le naufrage actuel de l’école inclusive ne cesse de montrer, malgré le grand désir de notre ministère de transformer tous les enseignants en experts psycho-médicaux ! Pour les professeurs, il n’est pas humainement possible d’embrasser en plus de leur mission de transmission des savoirs un rôle supplémentaire de soutien psychologique actif ou de veille médicale, tout en respectant leurs propres besoins en matière de santé mentale !
Le mal-être professionnel mine, dégrade la santé, et finalement dans sa dernière extrémité parfois… tue. Le SNCL refuse cet état de fait, de même qu’il refuse de participer à l’omerta généralisée sur la question de la souffrance au travail des professeurs. Notre santé et celle de nos élèves nécessitent des moyens, et ceci n’est pas négociable.