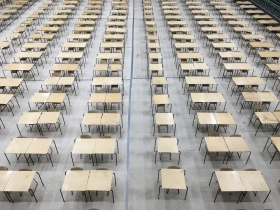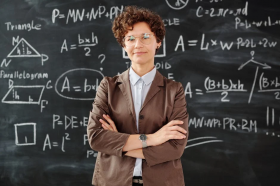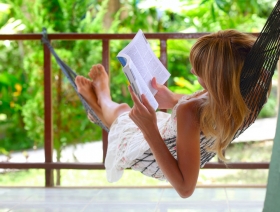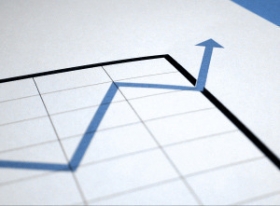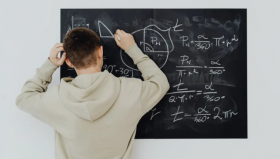Depuis le 1er septembre 2023, l’extension du principe de retraite progressive aux agents titulaires de la Fonction publique (qui existait déjà dans le secteur privé et pour les personnels contractuels) est entrée en vigueur. Cette fiche rappelle les textes de référence pour l’ensemble des salariés du privé et du public et leur application concrète pour les fonctionnaires de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.
Textes réglementaires :
-
Code des pensions civiles et militaires de retraite, Art. L 89 bis, L 89 ter ; D 37-1, D 37-2 et D 37-3 sur la retraite progressive des fonctionnaires de l’État ;
-
Circulaire interministérielle du 6 septembre 2023 relative à la gestion de la retraite progressive de l’État ;
-
Code de la sécurité sociale, Art L 161-22-1-5 et suivants sur le régime général de la retraite progressive ;
-
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié, sur la retraite progressive des agents des Fonctions publiques territoriale et hospitalière, Art 49 bis à 49 sexies.
Le principe :
Il s’agit pour tous ceux qui exercent à titre exclusif leur activité soit à temps partiel soit à temps incomplet d’être autorisés à percevoir un peu avant l’âge légal de la retraite un complément financier mensuel appelé “retraite progressive” calculé en fonction des droits acquis à la retraite et du pourcentage du temps non travaillé.
Par exemple, si votre quotité d’emploi est de 80%, vous aurez selon les conditions ci-après énumérées une retraite progressive ou une “pension partielle” de 20 %.
Le montant simulé de votre retraite pour établir votre complément prend en compte toutes les sommes accessoires (MPE, IMT, NBI, CTI, etc.) à la date du calcul.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. Le service de retraite de l’Etat qui sera considéré comme régime instructeur doit instruire une demande unique de retraite progressive auprès de tous les autres régimes de retraite concernés et leur communiquer la demande de l’agent.
Une fois acquis, le bénéfice du dispositif continue tant que vous restez à temps partiel et informez régulièrement l’administration de vos renouvellements. Il continue aussi même si vous continuez à travailler au-delà de l’âge légal de départ.
En revanche, si vous reprenez à temps plein, le bénéfice est perdu définitivement.
Les conditions de la retraite progressive
Il y a 3 conditions cumulatives qui devront être acquises à la date de début souhaité de la retraite progressive :
■ être à 2 ans ou moins de l’âge légal de départ à la retraite (pour un âge légal de départ à 64 ans, une retraite progressive ne pourra s’exercer qu’à partir de 62 ans). Mais attention : un Accord National Interprofessionnel (ANI) sur l’emploi des seniors prévoit notamment l’abaissement de l’âge d’accès à la retraite progressive à 60 ans pour tous les salariés, à partir de septembre 2025 ; voir plus bas « Du nouveau à la rentrée ? ».
■ avoir cotisé 150 trimestres ;
■ bénéficier d’un temps partiel compris entre 50 et 90 %.
Les restrictions
■ concernant l’âge : si vous bénéficiez d’un aménagement de votre âge légal de départ pour handicap, pénibilité, carrière longue, vous ne pourrez pas prétendre à la retraite progressive avant l’âge légal réglementaire pour tous ;
■ concernant le temps partiel : un temps partiel pour motif thérapeutique n’ouvre pas droit à la retraite progressive.
Les conditions d’âge pour prétendre à la retraite progressive
■ conditions déjà remplies pour les personnes nées avant 1964 ;
■ conditions remplies au 61eme anniversaire pour les personnes nées en 1964 ;
■ conditions remplies à 61 ans et 3 mois anniversaire pour les personnes nées en 1965 ;
■ conditions remplies à 61 ans et 6 mois pour les personnes nées en 1966 ;
■ conditions remplies à 61 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1967 ;
■ conditions remplies au 62eme anniversaire pour les personnes nées en 1968 et après.
ATTENTION : un projet de décret en cours pourrait ramener l’âge minimum à 60 ans pour tous dès le 1er septembre 2025 (voir ci-dessous, » du nouveau à la rentrée ? « ).
Le dépôt de la demande et le temps prévisionnel d’instruction des dossiers
■ Le dépôt de la demande
□ via le compte ENSAP (https://ensap.gouv.fr) ou la CARSAT du département pour les contractuels ;
□ contenu de la demande : préciser la date d’effet souhaitée qui ne peut être antérieure à celle de la demande ;
□ la date d’effet est celle de la date de la demande sur ENSAP, celle de la date de réception ou toute autre date postérieure.
■ Le délai d’instruction
□ Il est fixé à 6 mois ;
□ L’employeur doit adresser l’autorisation de travail à temps partiel au service des retraites de l’Etat 120 jours au moins avant la date d’effet souhaitée ;
□ Pour les enseignants, CPE, Psy-EN ce délai est réduit à 90 jours car leur demande de temps partiel n’est accordée que pour l’année scolaire et donc renouvelable chaque année.
■ La notification de la concession de pension partielle
□ Elle parvient avec un décompte de pension partielle indiquant tous les éléments pris en compte pour le calcul et le montant qui sera versé.
□ Elle parvient 30 jours avant la date d’effet souhaité.
□ Le pension est due le premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies sauf si elles sont réunies le premier jour du mois.
Les modalités d’évolution, de suspension et de fin de retraite progressive
Une fois les modalités du calcul de la retraite progressive déterminées, celles-ci ne pourront plus changer sauf en ce qui concerne le pourcentage du temps non travaillé. Toutefois en situation d’arrêt maladie ordinaire, longue durée ou longue maladie, le montant de la retraite progressive n’est pas remis en cause même si la prise en charge du fonctionnaire, elle, diminue.
■ L’évolution de la quotité de la retraite progressive
□ C’est l’employeur qui communique les changements sans délai ;
□ C’est le fonctionnaire qui veille à renouveler dans les temps son autorisation de travailler à temps partiel.
■ La suspension de la retraite progressive
□ Si l’une des 3 conditions et notamment le renouvellement de temps partiel n’est pas rempli, l’employeur informe sans délai le service des retraites de l’État qui suspend le paiement de la retraite progressive.
■ La fin de la retraite progressive
Dès que le service est repris à temps plein, le droit à la retraite progressive est perdu définitivement car le dispositif n’est mobilisable qu’une seule fois ;
□ Dès que la pension complète prend effet, le droit à la retraite progressive cesse.
La pension complète
La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte, la durée d’assurance et les services accomplis pendant la période de retraite progressive augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance.
Du nouveau à la rentrée ?
En novembre 2024, un Accord National Interprofessionnel (ANI) a programmé l’abaissement de l’âge requis pour l’entrée dans le dispositif de retraite progressive à 60 ans pour tous les salariés du secteur privé. Un projet de décret (attendu pour juin) doit concrétiser cette décision prochainement afin qu’elle puisse s’appliquer à partir du 1er septembre 2025. Or, lors d’une réunion de négociations sur les retraites, le 23 avril 2025, la DGAFP (Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique) a donné son accord de principe pour que ce droit soit aussi étendu aux fonctionnaires à la même date.
Depuis, une première mouture du décret a circulé : et celle-ci mentionne bien l’extension du droit à partir du 1er septembre prochain, au moins pour les fonctionnaires d’état (ce qui englobe les enseignants titulaires). Les choses sont moins claires pour les personnels contractuels de la fonction publique, mais il serait inimaginable que le texte final soit moins-disant pour ces derniers.
Maintenant, reste que ce décret n’est qu’un projet à l’heure où nous écrivons ces lignes, et le texte final ne sera publié au mieux qu’en juin : ce qui crée une incertitude injuste pour certains collègues. En effet, les collègues qui auront 60 ans à la rentrée se retrouveront dans deux cas de figures : soit ils seront déjà à temps partiel (parce qu’ils en ont déjà fait la demande ou prolongeront simplement un temps incomplet ou un temps partiel déjà accordé) et dans ce cas la retraite progressive pourra leur être versée dès le 1er septembre, soit ils auraient aimé bénéficier de la retraite progressive mais, sans certitude, n’auront pas fait de demande de temps partiel dans les temps… et se retrouveront donc obligés d’attendre un an de plus avant de pouvoir en bénéficier.
Face à cette situation, le SNCL demande :
– Que la publication du décret final soit faite dans les plus brefs délais.
– Que le ministère passe consigne aux rectorats d’étudier exceptionnellement les demandes tardives de temps partiel compatibles avec la retraite progressive et déposées par des collègues nés entre 1964 et 1966.
Vous avez des questions ou souhaitez être accompagné ? Contactez-nous au 09 51 98 19 42 ou sur communication@sncl.fr