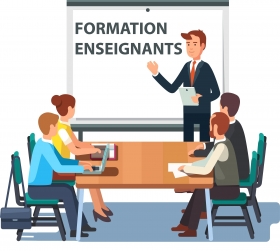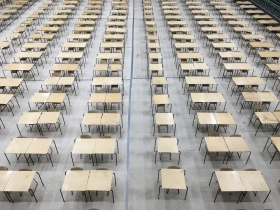Principes généraux
Le chèque-vacances est une prestation qui s’inscrit dans le cadre de l’action sociale de l’Etat au bénéfice de ses agents ; ses conditions d’attribution sont sensiblement semblables à celles du secteur privé (conditions de ressources). C’est un titre nominatif qui peut être remis aux collectivités publiques ou à des prestataires de service agréés en paiement de dépenses de vacances sur le territoire national (transport, hébergement, repas, activités de loisirs).
Ce titre de paiement repose sur une épargne de l’agent prélevée mensuellement par le prestataire et abondée d’une participation de l’employeur. C’est une épargne bonifiée par l’Etat dont la partie bonifiée n’est pas imposable.
Bénéficiaires
Il est accessible à tous les agents publics de l’Etat en activité, titulaires ou non, ainsi qu’à leurs ayants-cause (titulaires d’une pension de réversion), de même qu’aux AED sous contrat du chef d’établissement. Il n’est plus accessible aux retraités depuis octobre 2023.
Utilisation
Il est utilisable pour toute la famille, et toute l’année, en France (départements et régions d’Outre-Mer inclus) et dans l’Union Européenne.
Il sert à payer les dépenses de :
- restauration, hôtel, locations,campings,
- séjours en centres de vacances, gîtes, maisons familiales
- centres culturels, parcs de loisirs, bases de plein air, cinémas, théâtres, musées
- location de matériel de sport, écoles ou cours
- sociétés de transport
- établissements scolaires ( sorties, voyages)
- etc.
Les établissements qui acceptent ce titre de paiement affichent le macaron bleu « bienvenue chèques-vacances ».
Le Chèque-Vacances est valable 2 ans en plus de l’année d’émission et est échangeable en fin de validité.
Le Chèque-Vacances est disponible sous 2 formats :
- Chèque-Vacances Classic, le format papier : un chéquier disponible en coupures de 10, 20, 25 et 50 €, non sécables et à utiliser en face à face ou à envoyer par courrier.
- Chèque-Vacances Connect, le format 100% digital : une application mobile de paiement, utilisable en face-à-face ou sur Internet, au centime près, dès 20 euros d’achat.
- Pour plus d’informations, consultez le site www.ancv.com
Conditions de ressources et taux de bonification
1 – Conditions de ressources Le bénéfice du Chèque-vacances est soumis à condition de ressources, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, pour l’année N-2 pour une demande effectuée en année N et du nombre de parts du foyer fiscal du demandeur, apprécié à la date de la demande.
2 – Conditions relatives à l’épargne du bénéficiaire et à la bonification versée par l’État
Le taux de la bonification versée par l’État est modulé en fonction du revenu fiscal de référence N-2 et du nombre de parts du foyer fiscal en année N.
3 – Mesures en faveur des agents de moins de 30 ans
Ils bénéficient d’une bonification de leur épargne par l’Etat au taux de 35% toujours selon leurs conditions de ressources.
4- Mesures en faveur des agents en situation de handicap
Les agents en situation de handicap, en activité, remplissant les conditions d’attribution de la prestation, bénéficient d’une majoration à hauteur de 30 % de la bonification versée par l’État.
5 – Mesures en faveur des agents des agents affectés dans les départements d’ outre-mer
Le revenu fiscal de référence à retenir est déterminé après un abattement de 20% de sa valeur.
Pour toute information concernant le barême, consultez les pages 6 à 9 de la circulaire du 2 août 2023, ici : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45467
L’épargne mensuelle du bénéficiaire du Chèque-vacances doit être comprise, pendant une durée comprise entre quatre et douze mois, entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel.
Cumul des droits
Dans un ménage, si les deux conjoints travaillent, chacun d’eux peut demander à bénéficier de la prestation Chèque-vacances, qu’ils appartiennent tous les deux à la fonction publique ou que l’un des conjoints soit salarié du secteur privé. Dans ce dernier cas, seul le conjoint agent de la fonction publique bénéficie de la contribution de l’État. La prestation Chèque-vacances est cumulable avec les autres prestations servies au personnel de la fonction publique au titre de l’aide aux vacances (par exemple, séjours en colonies de vacances).
Modalités d’achat
La gestion des chèques-vacances est assurée par DOCAPOSTE, qui réalise, pour le compte de la DGAFP, l’instruction des demandes qui lui sont adressées par les agents de l’État.
Toutes les informations relatives à ce dispositif (y compris les formulaires de demande) sont disponibles sur le site internet spécifiquement dédié au dispositif :
www.fonctionpublique-chequesvacances.fr.
Sur ce site vous trouverez notamment un simualteur d’épargne qui vous permettra d’anticiper à la fois le montant mensuel de votre épargne et la durée de versement sur laquelle vous voulez vous engager, qui peut varier de 4 à 6 mois. Vous pourrez également visualiser votre bonification.
Textes réglementaires
- Article L 732-3 du code général de la fonction publique sur les aides aux vacances
- Articles L 731-1 à L 731-3 du code général de la fonction publique sur l’aide sociale en général dans la fonction publique
- Articles L 411-18 et L 411-19 du code du tourisme
- Circulaire du 2 août 2023 relative aux chèques-vacances
- Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat
- Arrêté du 22 décembre 2023 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 sur les prestations sociales interministérielles selon le type d’établissement d’exercice