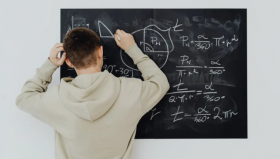Avertissement : ce dossier a été réalisé à partir des textes relatifs au mouvement publiés au BO n°39 du 16 octobre 2025, au BO spécial n° 5 du 31 octobre 2024 (calendrier et lignes directrices de gestion ministérielles en matière de mobilité).
Par ailleurs, nous rappelons que la loi n° 2019-828 dite de « transformation de la Fonction publique », a établi que les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour le mouvement.
Il est ainsi très important de prendre conseil auprès des représentants du SNCL pour faire valoir vos droits et s’assurer que tous vos éléments de barème sont bien pris en compte.
Retrouvez tout le contenu de cet article dans notre fiche pratique mutation 2026 à télécharger ici.
PHASE INTERACADÉMIQUE
• Du mercredi 5 novembre 2025… : ouverture des serveurs à 12 heures pour la formulation des demandes de participation à la phase interacadémique du mouvement,
• …au mercredi 26 novembre 2025 : fermeture des serveurs à 12 heures.
• À partir du 27 novembre 2025, votre confirmation individuelle de demande de mutation sera disponible en téléchargement dans l’application SIAM.
Cette opération est à réaliser vous-même.
Vous devez ensuite transmettre à votre chef d’établissement ce formulaire après l’avoir éventuellement corrigé de manière manuscrite et l’avoir signé, en l’accompagnant de toutes les pièces justificatives.
Les pièces justificatives devront être téléversées après visa du chef d’établissement.
31 août 2025 :
– Date limite des actes de mariage.
– Date limite d’établissement d’un pacte civil de solidarité (PACS).
31 décembre 2025 :
-Date limite des certificats de grossesse.
-Date limite de reconnaissance, par deux agents non mariés ni pacsés, d’un enfant né ou à naître.
• Début décembre 2025 : dépôt des dossiers pour les personnels détachés ou affectés en collectivités outre-mer qui sollicitent un changement d’académie au titre du handicap. Ils doivent déposer leur dossier directement auprès du médecin conseiller de l’administration centrale (72 rue Régnault 75243 Paris Cedex 13). Ce dossier doit contenir tous les justificatifs concernant le handicap.
Les demandes tardives de participation, d’annulation et de modifications sont possibles jusqu’au 6 février 2026, seulement si l’un des motifs suivants peut être invoqué :
• décès du conjoint ou d’un enfant ;
• perte d’emploi du conjoint ;
• mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement de personnels du ministère de l’Éducation nationale ;
• mutation imprévisible et imposée du conjoint ;
• situation médicale aggravée ;
• retour de détachement connu tardivement par l’agent.
ENVOYEZ LE DOUBLE DE VOTRE DEMANDE À VOS INTERLOCUTEURS SNCL MOUVEMENT 2026
• Les barèmes seront affichés sur SIAM à partir de la mi-janvier 2026 et jusqu’à la fin janvier 2026. En cas de désaccord, demandez la rectification de votre barème calculé auprès du rectorat via la plateforme COLIBRIS et adressez un double au syndicat en faisant des copies d’écran à communication@sncl.fr (après la fin de l’affichage, il sera trop tard).
• 11 mars 2026 : les résultats du mouvement interacadémique, SPEN et POP seront affichés sur I-Prof.
PHASE INTRA ACADÉMIQUE
(période préconisée par la note de service)
• À partir du 16 mars 2026 :ouverture des serveurs académiques pour la formulation des vœux pour la phase intra académique (dates précises définies par les services académiques).
• Fermeture des serveurs académiques : voir calendriers académiques.
• Mi-juin 2026 : annonce des résultats des mouvements intra académiques.
PERSONNELS CONCERNÉS
a) Participent obligatoirement
• Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires ainsi que ceux dont l’affectation au mouvement interacadémique 2025 a été reportée (renouvellement…) ;
• y compris ceux affectés dans l’enseignement supérieur (dans l’hypothèse d’un recrutement dans l’enseignement supérieur à l’issue de leur stage, l’affectation obtenue au mouvement interacadémique sera annulée) et ceux placés en position de congé sans traitement en vue d’exercer des fonctions d’ATER ou de moniteur ayant accompli la durée réglementaire de stage, conformément aux dispositions du décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 ;
• à l’exception des ex-titulaires d’un corps de personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation et d’orientation.
• Les personnels titulaires :
• affectés à titre provisoire au titre de l’année scolaire 2025-2026, y compris ceux dont l’affectation relevait d’une réintégration tardive ;
• actuellement affectés en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna, ou mis à disposition de la Polynésie française en fin de séjour, qu’ils souhaitent ou non retourner dans leur dernière académie d’affectation à titre définitif avant leur départ en collectivité d’outre-mer ;
• désirant retrouver une affectation dans l’enseignement du second degré, parmi lesquels ceux qui sont affectés dans un emploi fonctionnel ou dans un établissement privé sous contrat, qu’ils souhaitent ou non changer d’académie et ceux qui sont affectés en Andorre ou en écoles européennes.
b) Participent facultativement
• Les personnels titulaires :
– qui souhaitent changer d’académie,
– qui souhaitent réintégrer, en cours ou à l’issue de détachement ou de séjour, soit l’académie où ils étaient affectés à titre définitif avant leur départ (vœu prioritaire éventuellement précédé d’autres vœux), soit une autre académie,
– qui souhaitent retrouver un poste dans une académie autre que celle où ils sont gérés actuellement et qui sont en disponibilité, en congé avec libération de poste ou affectés sur un poste adapté (PACD ou PALD).
POUR NE PAS PERDRE VOS DROITS
N’oubliez pas de joindre impérativement à votre dossier et de numéroter les pièces justificatives, par exemple :
• Extrait d’acte de naissance d’un enfant reconnu par deux parents non mariés ni pacsés ou photocopie du livret de famille ;
• Attestation de l’activité professionnelle du conjoint ; inscription à France Travail ; contrat d’apprentissage ;
• Pièce justificative du domicile (quittance EDF, quittance de loyer) ;
• Attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un PACS ;
• Documents fiscaux pour les conjoints liés par un PACS ;
• Certificat de grossesse délivré au plus tard le 31 décembre 2025 ;
• Arrêté de reclassement pour ceux qui bénéficient de la prise en compte de services antérieurs (bonifications liées à l’échelon de reclassement) ;
• Dernier arrêté de nomination si vous étiez titulaire d’un corps de l’Education nationale avant réussite à un concours ;
• Dernier arrêté de promotion dans l’ancien corps pour les ex-titulaires reclassés à la titularisation.
DONNÉES ESSENTIELLES
Le mouvement se déroulera en deux phases :
• une phase interacadémique comprenant deux mouvements en parallèle :
– le mouvement interacadémique (30 vœux académiques possibles),
– le mouvement spécifique (vœux sur des postes spécifiques).
• une phase intra académique qui relève de la compétence du recteur.
Les demandes devront être formulées sur I-Prof :
http://www.education.gouv.fr/iprof-siam
Les barèmes et les résultats seront consultables à la même adresse.
LES CONSTANTES
Seront traitées en même temps :
– les demandes de mutation proprement dites,
– les premières affectations des stagiaires issus des différents concours de recrutement,
– les réintégrations.
Rappel : chacun doit saisir lui-même sa demande de mutation.
Les personnels recevront, dans leur établissement, un formulaire de confirmation de demande en UN SEUL exemplaire. Cet original sera signé et remis au chef d’établissement avec les pièces justificatives. L’intéressé devra faire des copies de ce seul original comme preuve de sa demande et des vœux formulés. Il convient de prévoir une copie pour le SNCL à adresser à communication@sncl.fr
Les pièces justificatives doivent être fournies avec le dossier (formulaire) sous peine de perte des bonifications escomptées.
Postes spécifiques :
Les postes spécifiques font l’objet d’une publicité via I-Prof à partir du 6 novembre 2025.
La formulation des vœux s’effectuera sur SIAM I-Prof du 5 au 26 novembre à 12 heures.
Les chefs d’établissement sont étroitement associés à la sélection.
Les candidats doivent impérativement rencontrer le chef d’établissement d’accueil pour un entretien et lui transmettre leur dossier de candidature.
Les chefs d’établissement d’accueil communiqueront leurs appréciations à l’inspection générale avant la mi-décembre 2025.
BARÈME DES MUTATIONS
PHASE INTER ACADÉMIQUE
Le barème est calculé pour chaque vœu « académie ».
Il comprend :
• des éléments communs à tous les vœux :
– ancienneté de service (échelon) ;
– stabilité dans le poste (en années y compris 2025/2026).
• des bonifications éventuelles liées :
– à la situation administrative ;
– à la situation individuelle ;
– à certains types de vœux formulés ;
– à la situation familiale.
ÉLÉMENTS COMMUNS
A – Ancienneté de service :
Classe normale
• 7 points par échelon atteint au 31 août 2025 par promotion (et au 1er septembre 2025 par classement initial ou reclassement), quel que soit le grade (14 points minimum pour le total de ces points et forfaitairement pour les 1er et 2ème échelons).
Hors classe
• 56 points + 7 points par échelon de la hors classe pour les certifiés, PLP et PEPS.
• 63 points + 7 points par échelon de la hors classe pour les agrégés. Les agrégés hors classe au 4ème échelon depuis plus de 2 ans peuvent prétendre à 105 points.
Classe exceptionnelle
• 77 points + 7 points par échelon (dans la limite de 105 points).
Remarque :
Pour les stagiaires précédemment titulaires d’un corps de fonctionnaires, non reclassés à la date de stagiarisation, l’échelon à prendre en compte est celui acquis dans le grade précédent. Joindre obligatoirement l’arrêté justificatif du classement.
B – Ancienneté dans le poste (au 31-08-2026) en qualité de titulaire :
• 20 points par an,
• + 50 points par tranche de 4 ans.
Pour les titulaires sur zone de remplacement, l’ancienneté prise en compte est celle de l’affectation dans la zone géographique actuelle.
Remarques :
• En cas de réintégration dans l’ancienne académie, ne sont pas interruptifs de l’ancienneté dans un poste :
– le congé de mobilité ;
– le service national actif ;
– le détachement en cycles préparatoires (CAPET, PLP, ENA, ENM) ;
– le détachement en qualité de personnel de direction ou d’inspecteur stagiaire ;
– le congé de longue durée ou de longue maladie ;
– le congé parental ;
– une période de reconversion pour changement de discipline.
• Pour les personnels titulaires qui ont bénéficié d’une affectation ministérielle provisoire en 2025-2026, on tiendra compte de l’ancienneté acquise dans le dernier poste et de l’année d’affectation provisoire qui a suivi.
• Pour les stagiaires « ex-titulaires » : prise en compte d’une année d’ancienneté.
• Pour les personnels détachés, on prend en compte l’ensemble des années consécutives effectuées en détachement comme titulaire.
• Les personnels ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de carte scolaire conservent l’ancienneté d’affectation acquise sauf s’ils ont demandé et obtenu un poste sur un vœu non bonifié.
• Pour les personnels sur poste adapté, est prise en compte l’ancienneté dans l’ancien poste augmentée du nombre d’années effectuées sur le poste adapté.
BONIFICATIONS
C – Bonifications liées à la situation administrative
■ Personnels affectés en éducation prioritaire
Conditions :
– être en REP, REP+ ou en établissement relevant de la politique de la ville au moment de la demande de mutation,
– 5 ans d’exercice continu dans le même établissement.
La mutation par mesure de carte scolaire n’est pas interruptive.
Bonification 1 :
• 400 points à partir de 5 ans en REP+ ou établissement relevant de la politique de la ville,
• 200 points à partir de 5 ans en REP.
■ Personnels affectés par le mouvement national des postes à profil s’étant engagés à y rester au moins 3 ans
Bonification 2 :
• 120 points à partir de 3 ans exercés en continu sur le poste à profil d’un établissement engagé dans un contrat local d’accompagnement.
■ Personnels affectés à Mayotte
Bonification 3 :
• Une bonification de 1 000 points sur tous les vœux exprimés pour les personnels comptabilisant au 31 août 2026 au moins 5 ans d’exercice effectif et continu sur le territoire de Mayotte.
■ Personnels affectés à Guyane
Bonification 4 :
• Une bonification de 200 points sur tous les vœux exprimés pour les personnels affectés en Guyane depuis au moins 5 ans et comptabilisant au 31 août 2026 au moins 2 ans d’exercice effectif et continu sur un poste isolé
D – Bonifications liées à la situation individuelle
■ Stagiaires
Bonification 5 :
Utilisable une fois au cours d’une période de 3 ans.
• 10 points sur le vœu 1
La bonification utilisée à l’inter restera valable à l’intra si le barème académique le prévoit.
■ Académie de stage ou d’inscription au concours
Bonification 6 :
Stagiaires : 0,1 point pour l’académie de stage et/ou 0,1 point pour l’académie d’inscription au concours.
■ Lauréats de concours :
1. Stagiaires ex-enseignants contractuels du 2nd degré de l’Education nationale, ex-CPE contractuels, ex-COP/PsyEN ou PE psychologues contractuels, ex-MA garantis d’emploi, ex-MI-SE lauréats d’un concours de CPE ou ex-emploi avenir professeur (EAP), ou ex contractuels CFA. Cette bonification est forfaitaire quel que soit le nombre d’années de stage.
Les EAP doivent justifier de deux années en cette qualité. Les autres doivent justifier de services traduits en équivalent temps plein égaux à une année scolaire au cours des deux années précédant leur stage.
Bonification 7 :
Cette bonification est attribuée en fonction du reclassement au 1er septembre 2025.
• 150 points pour un classement au 3ème échelon,
• 165 points pour un classement au 4ème échelon,
• 180 points pour un classement au 5ème échelon et au-delà.
2. Stagiaires précédemment titulaires d’un corps autre que ceux de personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ou personnels sollicitant leur réintégration.
Bonification 8 :
• 1 000 points sur le vœu correspondant à leur académie d’affectation avant réussite au concours.
3. Personnels sollicitant leur réintégration à divers titres.
■ Demandes formulées au titre du handicap
Agent ou conjoint entrant dans le champ des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue dans la loi du 11 février 2005.
Bonification 9 :
• 100 points
Agent ayant obtenu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour eux, leur conjoint ou du handicap pour un enfant.
– Tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée.
– S’agissant d’un enfant non reconnu, handicapé ou souffrant d’une maladie grave, toutes les pièces concernant le suivi médical notamment en milieu hospitalier spécialisé.
Bonification 10 :
• 1 000 points
Les bonifications 9 et 10 ne sont pas cumulables.
E – BONIFICATIONS LIÉES AUX VŒUX FORMULÉS
■ Vœu préférentiel
Bonification 11 :
• 20 points par an à partir de la deuxième demande déposée consécutivement. Pour continuer à obtenir la bonification annuelle, il y a obligation d’exprimer chaque année de manière consécutive en premier rang le même vœu académique.En cas d’interruption ou de changement de stratégie les points cumulés sont perdus.
– Cette bonification est désormais plafonnée à 100 points.
– Clause de sauvegarde pour ceux ayant acquis un barème supérieur à 100 points antérieurement au mouvement 2016.
– Bonification non cumulable avec les bonifications liées à la situation familiale.
■ Vœu sur un DOM ou sur Mayotte.
Etre natif du DOM ou avoir son CIMM dans ce DOM en exprimant DOM ou Mayotte en vœu de rang 1. Bonification non prise en compte en cas d’extension.
Bonification 12 :
• 1 000 points
■ Vœu unique sur la Corse :
Bonification 13 :
• 600 points pour la première demande pour les seuls stagiaires dans l’académie de Corse en 2024/ 2025 ;
• 800 points pour la deuxième demande consécutive ;
• 1 000 points à partir de la troisième demande consécutive et plus.
Bonification 14 :
• 1 400 points pour les stagiaires effectuant leur stage en Corse et ex-MA, ex-enseignants contractuels, CPE contractuels, PsyEn contractuels, AESH, ou EAP en situation en Corse si justification d’un an de service à temps complet les deux années précédentes (sauf pour les ex-EAP qui doivent justifier de 2 ans en cette qualité).
Le cumul est possible avec certaines bonifications notamment le vœu préférentiel et/ou les bonifications familiales.
F – BONIFICATIONS LIÉES À LA SITUATION FAMILIALE
Sont considérées comme « conjoints » les personnes qui, au plus tard le 31 août 2025,
– sont marié(e)s ou,
– sont pacsé(e)s avec imposition fiscale commune ou,
– ont la charge d’au moins un enfant (de moins de 18 ans au 1er septembre 2026) reconnu par l’un ou par l’autre ou,
– ont reconnu par anticipation, au plus tard le 31 décembre 2025, un enfant à naître.
De plus, les situations ne sont prises en compte que pour les personnels dont le « conjoint » exerce une activité professionnelle ou est inscritcomme demandeur d’emploi auprès de « France Travail », après cessation d’une activité professionnelle intervenue après le 31 août 2022.
Le rapprochement pourra porter sur la résidence privée sous réserve de compatibilité entre celle-ci et l’ancienne résidence professionnelle.
■ Rapprochement de conjoints (RC)
Bonification 15 :
• 150,2 points pour l’académie de résidence professionnelle du conjoint (si elle est placée en premier vœu) et les académies limitrophes, cette bonification est non cumulable avec les bonifications RRE (rapprochement de la résidence de l’enfant) et MS (mutation simultanée). La résidence privée du conjoint peut être prise en compte si elle est compatible avec le lieu d’exercice.
■ Mutation Simultanée entre deux agents titulaires ou deux agents stagiaires
Bonification 16 :
• 80 points sur l’académie saisie en vœu n°1 et les académies voisines pour les agents conjoints.
■ Autorité parentale conjointe
Bonification 17 :
• 250,2 points pour 1 enfant pour l’académie de résidence professionnelle de l’autre parent (et les académies limitrophes) puis 100 points par enfant supplémentaire.
■ Bonification pour enfant à charge :
Enfant(s) de moins de 18 ans au 1er septembre 2026.
Bonification 18 :
• 100 points par enfant à charge
■ Bonification pour année scolaire de séparation
Les stagiaires qui n’ont jamais été employés par l’Education nationale ne sont pas concernés.
La situation de séparation est appréciée au 1er septembre 2026 et doit couvrir au moins une période de six mois et pour des situations familiales établies au plus tard au 31 août 2025. Chaque année de séparation doit être justifiée, lorsque le conjoint n’est pas géré par la DGRH.
Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
– les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint;
– les périodes de position de non activité ;
– les congés de longue durée et de longue maladie ;
– le congé pour formation professionnelle ;
– les années pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d’emploi ou effectue son service national ;
– les années pendant lesquelles l’enseignant n’est pas affecté à titre définitif dans l’enseignement du second degré public ou dans l’enseignement supérieur.
Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation.
Les départements 75, 92, 93, 94 forment une même entité : aucune année de séparation n’est comptabilisée à l’intérieur de celle-ci.
Bonification 19 :
Agents en activité :
• 190 points sont accordés pour la première année de séparation ;
• 325 points sont accordés pour deux ans de séparation ;
• 475 points sont accordés pour trois ans de séparation ;
• 600 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation.
Les éléments de barème ont été maintenus, mais cela est trompeur. En effet le ministère a réaffirmé sa volonté d’augmenter, le nombre et le type de postes « à profil » aux niveaux national et académique.
Rappelons également par ailleurs, que les lignes directrices de gestion spécifient que le barème n’est qu’indicatif.
Le SNCL dénonce cette politique où l’administration est ainsi la seule à juger des profils et peut ne pas respecter le classement des candidats issu des barèmes.
Retrouvez tout le contenu de cet article dans notre fiche pratique mutation 2026 à télécharger ici.