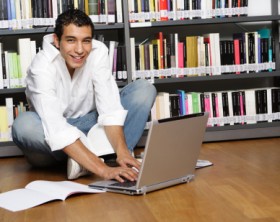I – LA DÉMARCHE DU S.N.C.L.
Le S.N.C.L. s’alarme de l’accumulation de témoignages convergents de professeurs, jeunes ou expérimentés, faisant état de l’impossibilité d’exercer le métier d’enseignant dans un nombre croissant de collèges. Le redoublement des incivilités et des actes de violence dont les élèves sont les premières victimes mais qui n’épargne pas les personnels constitue, à nos yeux, un changement radical dans le mode d’exercice du métier d’enseignant d’où l’urgence d’une réponse adaptée à des situations de plus en plus inédites sur le terrain.
Nos collègues sont également sensibles à la situation d’élèves qui viennent au collège «la peur au ventre» et de ceux qui, ayant perdu pied depuis longtemps, se désespèrent, conscients de s’enliser inéluctablement dans une spirale d’échec scolaire qui leur ôte toute perspective d’avenir.
Tous ces témoignages mettent en lumière l’incapacité de notre système éducatif à prendre en charge certains élèves en grande difficulté et à traiter le problème grave du comportement de ceux qui viennent au collège contraints et forcés, rejettent complètement l’Ecole et qui, parce qu’ils sont entrés dans un cycle redoutable : échec à révolte à violence, empêchent les autres élèves de travailler.
Dans leur majorité les enseignants déplorent souvent que les élèves n’éprouvant pas de difficultés soient freinés, perdent souvent leur temps et s’ennuient au collège.
Tous ces témoignages, ne font que renforcer l’idée du caractère indispensable de repenser le collège afin d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité d’où nos propositions.
Dès l’année 2000, le S.N.C.L. avait dressé un «état des lieux» du collège unique, vingt-cinq ans après sa création, puis procédé à une analyse sans complaisance de la situation et avait constaté que, dans les faits le collège unique créé en 1975 n’existait plus. Il n’avait d’ailleurs jamais complètement trouvé son identité.
Alors que dire aujourd’hui ? Sinon que le collège dit « unique » a été au fil des ans transformé en un « collège uniforme », laissant sur le carreau des cohortes d’élèves ! Et ce n’est certainement pas la mise en œuvre du socle commun qui peut apporter des réponses suffisantes à l’échec scolaire et à l’inégalité des chances.
Le Ministre de l’Education nationale doit en tirer, sans délai, toutes les conséquences.
II – CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS DU COLLÈGE UNIQUE
Le vote de la Loi, en 1975, concrétisait près de 50 années d’évolution marquées par l’échec global de 23 tentatives de réforme ; la dernière, le projet FONTANET, datant de 1973. Le S.N.C., dont notre syndicat est issu, avait été l’un des artisans les plus actifs de cette évolution.
Le «collège unique» se fixait alors pour objectifs de supprimer les filières et de regrouper tous les enfants dans les mêmes classes des mêmes collèges pour opérer un brassage social.
Ce brassage social était destiné à favoriser l’égalité des chances, – l’un des objectifs forts de la Loi de 1975 -.
Devant l’absence de résultats significatifs et pour tenir compte de l’évolution de la société, ces objectifs furent ensuite complétés par la loi d’orientation sur l’Education de 1989 :
– conduire tous les jeunes à la fin de la classe de 3e par des voies diversifiées, y compris dans des classes de 4e et de 3e préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle,
– conduire avant l’année 2000 l’ensemble d’une classe d’âge, au minimum, au niveau du C.A.P.
La loi précisait en outre les obligations des élèves : l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études, l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
III – L’ÉTAT DES LIEUX DU COLLEGE UNIQUE
La suppression officielle des filières constituait à la fois un abus de langage puisqu’il restait déjà à l’époque deux filières distinctes au collège : les classes de la S.E.G.P.A. et les autres classes.
Elle constituait surtout une consternante hypocrisie puisqu’elle s’accompagnait, dans les classes hors S.E.G.P.A., de la mise en place simultanée de filières déguisées, encore plus injustes car s’opérant sur des critères sociaux et sur une bonne connaissance du fonctionnement du système éducatif (choix de classes ou d’options rares, classes «C.A.M.I.F.», …).
Il faut noter que la mise en place de ces filières déguisées n’était pas l’apanage de quelques premiers cycles de lycées prestigieux mais se développait y compris dans des zones défavorisées pour tenter d’éviter le départ des meilleurs élèves. Ce phénomène déjà ancien s’est encore amplifié depuis.
C’était d’ailleurs la seule façon pour ces établissements de ne pas perdre les élèves moyens ou bons qu’ils scolarisaient encore et d’éviter le phénomène de ghettoïsation que ces départs allaient accentuer.
De plus, les enseignants déploraient que les classes totalement hétérogènes étaient de plus en plus souvent ingérables, les élèves les plus faibles s’enfonçant dans l’échec scolaire, alors que les meilleurs perdaient en partie leur temps.
Tous les élèves ne peuvent avancer au même rythme, ni acquérir la totalité des mêmes savoirs. Il faut permettre à chaque élève d’aller au maximum de ses possibilités en progressant à son rythme.
En outre, le système éducatif ne permet pas à un élève dont la maturité intervient tardivement de rattraper son retard, puisque aucun dispositif n’est prévu dans ce sens.
Le brassage social dans les mêmes établissements était de plus en plus contourné. De multiples procédés étaient déjà utilisés par un nombre croissant de familles pour choisir le collège d’affectation de leur enfant : classes à thème, choix d’options rares, changement de domicile ou domiciliations fictives, etc.
Lorsque ces procédés échouaient et lorsque les revenus de la famille le permettaient, les élèves étaient inscrits dans l’enseignement privé.
Phénomène qui ne fait que s’intensifier aujourd’hui avec la suppression de la carte scolaire. Les personnels des établissements publics se sentaient, comme ils se sentent aujourd’hui encore, pris au piège puisque la volonté de respecter le principe de brassage social aboutissait au résultat inverse.
Même si cela déplait, il faut constater que le brassage social est de plus en plus partiel car ce principe se heurte à un autre principe de notre société : la dualité scolaire.
L’objectif de conduire l’ensemble d’une classe d’âge au moins au C.A.P. en l’an 2000, que nous approuvions, n’était pas non plus atteint. Il ne l’est toujours pas en 2010.
Les chiffres ministériels font toujours état de 60 000 à 160 000 jeunes quittant chaque année le système éducatif sans diplôme ou qualification selon que le Brevet des Collèges est compté ou non comme qualification. Certes, l’échec scolaire s’est lentement et progressivement réduit, mais il reste trop lourd au regard de ses conséquences sociales comme le confirmaient les données de l’I.N.S.E.E. sur le chômage aggravé et persistant des «sans diplôme».
Nous pensions déjà que cet objectif était irréaliste, tout comme l’est en 2010 l’obligation de résultat faite à l’Ecole par la loi FILLON de 2005, à moins de finir par donner systématiquement un diplôme à tous les élèves puisque le nombre des jeunes déscolarisés augmentait fortement. Le Collège et le Lycée professionnel n’ont toujours pas la possibilité d’obliger les élèves qui rejettent l’institution scolaire sous toutes ses formes à travailler.
La diversification des voies de formation au Collège inscrite dans la loi d’orientation de 1989 s’était, à l’inverse considérablement réduite. La suppression du palier d’orientation en 5e puis des classes de 4e et de 3e technologiques concentrait le collège sur l’enseignement général, ce qui contribuait déjà à instituer une orientation basée seulement sur l’échec dans ces disciplines et contribuait à dévaloriser l’enseignement professionnel.
De plus, il existait encore des 4e d’aide et de soutien, des 3e d’insertion, des C.L.I.P.A., en petits nombres mais mal connues des familles et même des personnels. En 2010, elles ont presque totalement disparu.
Les dispositifs de «consolidation», de «remise à niveau» et de «soutien» mis en place peuvent certes aider des élèves lents ou rencontrant des difficultés légères ou passagères, mais ils s’avèrent toujours incapables de permettre aux élèves éprouvant de grosses et persistantes difficultés de combler leurs lacunes. Bien au contraire, il arrive parfois qu’au collège les écarts se creusent encore.
Des résultats qui, malgré l’empilement de dispositifs divers restent faibles, provoquant inéluctablement une démobilisation totale des élèves .
Les mesures coercitives mises en place (signalement au Procureur de la République, suppression des allocations familiales) peuvent obliger des élèves à franchir la porte du collège, mais l’institution ne peut pas les contraindre à assumer leurs obligations pourtant explicitement prévues par la Loi.
Bref, le «collège unique» ne constitue plus qu’un leurre que l’Education nationale continue d’entretenir en réaffirmant des dogmes inapplicables dont elle organise elle-même la transgression, par réalisme le plus souvent (dispositifs relais par exemple).
Cette contradiction est de plus en plus mal vécue par les personnels qui en subissent directement et durement les conséquences, notamment sur leurs conditions de travail.
IV – LES RAISONS DE L’ÉCHEC
- Constatons tout d’abord que l’édifice créé par la loi de 1975 était très imparfait.
En effet, si les élèves étaient rassemblés dans les mêmes classes des mêmes établissements, le législateur laissait sans solution les problèmes découlant de la multiplicité des corps professoraux et, pour certains d’entre eux, de l’absence de formation adaptée à ce cycle d’enseignement spécifique.
Nous déplorons qu’aucun progrès n’ait été réalisé depuis.
- La deuxième raison réside dans les politiques successives de restrictions budgétaires qui ont entraîné une augmentation des effectifs des classes et une aggravation des conditions de travail pour les élèves et leurs enseignants.
La suppression de l’effectif de référence de 24 élèves par classe fut la 1ère étape de l’augmentation des effectifs.
Aujourd’hui, la «dotation horaire globale», insuffisante, ne permet pas aux chefs d’établissement d’appliquer toutes les directives et recommandations officielles malgré la diminution de l’horaire d’enseignement de certaines disciplines.
En collège, cette insuffisance empêche notamment la constitution de groupes à effectifs réduits dont les enquêtes démontrent que, pour de jeunes élèves, ils favorisent la réussite scolaire.
Ces restrictions budgétaires successives traduisent une gestion plus comptable que pédagogique du système éducatif. Elles aboutissent à une uniformisation des structures pédagogiques sur le modèle le plus économique, au mépris de l’intérêt des élèves. C’est ainsi que la dotation horaire spécifique des S.E.G.P.A. a bien failli disparaître pour être fondue dans la dotation générale du collège, beaucoup plus malléable. Il a fallu la fermeté des interventions du S.N.C.L., notamment, pour s’opposer à cette fusion.
Les restrictions budgétaires sont également appliquées par les collectivités locales de plus en plus sollicitées. Ainsi, ces dernières privilégient la construction de grands établissements ou agrandissent ceux qui existent. Or, de trop grands collèges renforcent l’anonymat empêchant certains élèves de s’épanouir et engendrant un sentiment d’impunité qui favorise le développement de la violence.
- La troisième raison correspond à l’incapacité des décideurs politiques d’adapter le fonctionnement du collège aux évolutions de la société ou d’assumer les conséquences nées de l’opposition entre les principes du collège unique d’origine et l’évolution de la société, laissant les personnels désemparés face à ces contradictions. Et ce n’est certainement pas la mise en œuvre défaillante à tous les niveaux du socle commun de connaissances et de compétences depuis 2006 qui peut permettre de régler les problèmes du Collège et d’améliorer les conditions d’exercice de nos collègues. Bien au contraire !
Alors qu’il aurait fallu diversifier les démarches de formation et les structures d’accueil, les «voies diversifiées» prévues lors de la création du collège unique ont été progressivement uniformisées, pour des raisons idéologiques et financières, ou taries. Les mesures d’individualisation et de soutien qui ont été instaurées en compensation restent sans effet sur les élèves qui sont en trop grande difficulté pour en tirer bénéfice.
Le « collège unique » est devenu « collège uniforme », totalement inadapté à la diversité des élèves.
Le principe de scolarisation obligatoire dans les mêmes classes des mêmes établissements rend quasiment inapplicable l’imposition des obligations des élèves prévues par la Loi d’orientation puisqu’ils ne peuvent être exclus de ces classes, tout au plus peuvent-ils être envoyés dans un autre établissement.
Pire encore, certaines décisions ont privé les personnels des quelques moyens dont ils disposaient pour faire respecter la discipline par les élèves.
- La quatrième raison doit être cherchée dans le nombre croissant d’élèves qui accèdent au collège sans maîtriser les outils de base des disciplines instrumentales (lecture, écriture, modes opératoires). Leur nombre varie de 21 à 35 % selon les années et les sources. Phénomène aggravé par la réduction progressive des heures d’enseignement dans ces disciplines.
Le rapport FERRIER de juillet 1998 fait état de disparités fortes concernant le temps consacré à ces apprentissages selon les classes de cours préparatoire (7 h 30 à 16 h par semaine en français et de 3 h à 7 h en mathématiques.).
Et l’Inspecteur général FERRIER d’ajouter : «la qualité des apprentissages et les progrès des élèves sont en relation directe avec le temps consacré aux apprentissages».
Comment et par quel miracle les enseignants du Collège qui n’ont jamais été formés pour l’apprentissage des disciplines instrumentales pourraient-ils réussir seuls, en un an ou deux, à raison de quelques heures de soutien par semaine, là où des personnels formés (instituteurs et professeurs des écoles) assistés de spécialistes constatent l’échec, après 5 années de travail et d’efforts ?
Face à un Collège déstabilisé et pédagogiquement déstructuré, le réalisme doit plus que jamais prévaloir sur les dogmes.
V – CONSTRUIRE LE « COLLEGE POUR TOUS » AU SEIN DE « L’ECOLE DE LA REUSSITE »
Si le Collège unique n’est plus adapté aux caractéristiques et aux exigences de la société française de ce début du XXIième siècle de prise en charge de tous les élèves, ce n’est pas par un retour global aux méthodes d’avant 1975, encore moins adaptées, que l’on améliorera la situation.
Ce n’est pas vers une «restauration» qu’il faut aller. Nous devons au contraire nous attacher résolument à reconstruire le Collège sur des bases nouvelles et des fondations solides.
L’Ecole de la réussite constitue une exigence morale au regard de l’objectif de donner une qualification à chaque jeune.
Depuis la Loi d’orientation de 1989, le Collège ne constitue plus le cycle terminal de la scolarité obligatoire mais son cycle central. Son articulation avec le Lycée, sous ses différentes formes, est donc tout aussi essentielle que la charnière école-collège.
Elément central de la scolarité obligatoire le Collège doit prendre en charge tous les élèves qui en acceptent les règles, mais de façon beaucoup plus diversifiée pour apporter une réponse pertinente à leur extrême diversité.
Cette diversification doit aller jusqu’à ce qu’un élève administrativement rattaché à un collège puisse suivre une partie de sa scolarité en dehors de ses murs.
Dans un souci d’efficacité et d’égalité, la Nation doit se fixer des orientations ambitieuses pour l’Ecole de la République, adaptées aux exigences de la société actuelle et empreintes de pragmatisme.
C’est à la Nation, au travers de ses représentants, d’assurer la cohérence d’objectifs crédibles assignés au système éducatif.
Il ne s’agit donc pas simplement de juxtaposer un ensemble de mesures techniques pour donner un petit «coup de jeune» à notre système éducatif, mais de définir des orientations globales, structurées et complémentaires, pour ses différents niveaux.
Pour que ces orientations soient largement partagées et pour mettre en phase décideurs politiques, personnels et usagers, on ne peut faire l’économie d’un débat national sur le Collège.
Parce que le rôle de la famille et de l’Ecole sont complémentaires, ce débat doit associer largement les représentants des personnels et des usagers du système éducatif pour éviter les incompréhensions, les prises de position doctrinaires ou inapplicables comme cela a été trop souvent le cas dans le passé.
La réforme ambitieuse Collège dont le S.N.C.L. demande la mise en oeuvre doit déboucher sur des mesures novatrices s’articulant autour des orientations suivantes :
1 L’objectif du système éducatif consiste à conduire chaque jeune au maximum de ses possibilités c’est à dire avec l’objectif d’au moins un C.A.P., sans qu’il puisse constituer une obligation de toute façon inapplicable.
Dans ce cadre, la durée de la scolarité peut être prolongée au-delà de 16 ans dès lors que l’élève en fait la demande et qu’il respecte les règles de fonctionnement de la communauté éducative. Les années non utilisées par un jeune lui ouvrent droit à reprise ultérieure d’études (ce point est développé dans le texte de l’orientation n° 10).
Cette scolarité obligatoire extensible constitue la première étape d’une formation pouvant ou devant désormais être complétée à différentes périodes de la vie active. Durant cette prolongation, la gratuité des fournitures et de l’enseignement sera assurée.
Par contre, le SNCL n’est pas favorable à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, ce qui aurait pour conséquence de maintenir deux ans de plus dans les établissements des jeunes déjà en rejet complet du système éducatif.
2 La durée de la scolarité se répartit obligatoirement sur trois types d’établissements et pourrait alors se décomposer ainsi :
- l’Ecole élémentaire, durée de 5 à 6 ans, les élèves accèdent au Collège entre 10 et 12 ans ;
- le Collège, durée de 4 à 5 ans (exceptionnellement 6 si aucun retard scolaire à l’entrée au Collège), les élèves accèdent au Lycée entre 14 et 17 ans ;
- en Lycée, durée de 2 à 4 ans exceptionnellement 5 si aucun retard scolaire à l’entrée au Lycée (2 ans correspondent à certaines formations C.A.P).
3 Un objectif prioritaire est assigné à chaque type d’établissement :
– pour l’Ecole élémentaire, l’acquisition des connaissances instrumentales de base (lecture, écriture, expression orale, modes opératoires),
– pour le Collège, la consolidation et l’approfondissement des connaissances, l’apprentissage du travail autonome et la préparation aux grands choix d’orientation,
– pour le Lycée, sous ses différentes formes, la différenciation de l’orientation, la préparation de l’insertion professionnelle et de la poursuite d’études.
Il faut noter que la réussite au Collège et au Lycée dépend étroitement du parcours scolaire antérieur même si d’autres éléments entrent en ligne de compte.
4 Dans chaque type d’établissement l’essentiel de l’horaire d’enseignement et d’éducation sera consacré à la réalisation des objectifs prioritaires. Ces objectifs seront déclinés en un ensemble de savoirs et de savoir-faire nécessaires soit à la poursuite des études dans le type d’établissement qui suit, soit à l’exercice d’un métier.
Un bilan des acquisitions des élèves sera effectué à intervalles réguliers, et de véritables actions de remédiation sont déclenchées sans délai.
Le temps supplémentaire passé à l’Ecole élémentaire par un élève sera utilisé pour lui faire acquérir, dans des groupes à effectifs très réduits, les notions de base des disciplines instrumentales qui lui manquent encore.
5 Les élèves qui n’éprouvent pas ou peu de difficultés et qui constituent la majorité, sont scolarisés dans des classes totalement hétérogènes.
Pour ces élèves, il faut également cultiver l’intérêt, entretenir le goût de l’effort en proposant à ceux qui le souhaitent divers approfondissements et des options plus nombreuses.
6 Lorsque, malgré les dispositifs évoqués précédemment, un élève a accompli la durée maximale de la scolarité en Ecole élémentaire (y compris l’année supplémentaire de rattrapage intense en groupes à effectifs réduits) sans avoir les prérequis indispensables à une scolarité au Collège, il sera néanmoins pris en charge en Collège.
Après avis d’une commission départementale pluriprofessionnelle (psychologue, assistante sociale, médecin scolaire, enseignants) présidée par l’Inspecteur d’Académie, l’élève sera placé dans l’une des classes suivantes :
- Dans une classe semi-hétérogène pour les élèves ayant des difficultés dont la persistance aggrave l’acuité.
Dans la ou les disciplines instrumentales dans laquelle ou lesquelles des carences persistent, l’élève suit alors un enseignement spécifique en groupes homogènes à effectifs très réduits et à la place des heures d’enseignement de la ou des disciplines correspondantes de sa classe.
Il est pris en charge par des enseignants du second degré spécialement formés et s’appuyant sur une équipe pluriprofessionnelle composée notamment de personnels sociaux et de santé.
- Dans une S.E.G.P.A. pour les élèves qui éprouvent les plus lourdes difficultés scolaires et qui présentent des perturbations sur le plan de l’efficience intellectuelle. Les enseignants de la S.E.G.P.A. conserveront leur formation spécifique mais seront intégrés dans un corps de personnels du second degré. L’intégration de la S.E.G.P.A. dans le Collège sera développée.
7 Pour fonctionner convenablement, le système éducatif doit avoir les moyens (matériels, financiers et humains) lui permettant d’atteindre les objectifs ambitieux qui lui sont assignés.
- Les dotations horaires des établissements doivent être calculées non en application de règles technocratiques mais, en fonction des besoins pédagogiques réels des collèges, en intégrant notamment le nombre des élèves en grande ou très grande difficulté et les moyens supplémentaires que leur prise en charge nécessite. Les S.E.G.P.A. conservent leur dotation spécifique.
Ces besoins pédagogiques réels seront définis par les horaires officiels des différents niveaux, pour tous les enseignements obligatoires. Ils seront calculés sur la base de 24 élèves maximum par classe et permettront de constituer des groupes à effectifs plus réduits, dont on sait qu’ils favorisent la réussite scolaire. En outre, un large choix d’options sera proposé aux élèves.
Les contenus des programmes devront être adaptés aux capacités de la grande majorité des élèves.
- Parallèlement, il faut augmenter sensiblement le nombre des nouveaux enseignants recrutés pour faire face à l’augmentation globale de la charge de travail qu’une véritable réforme du Collège entraînera, s’ajoutant aux nombreux départs en retraite programmés.
Les responsables politiques doivent en effet comprendre qu’un système éducatif ayant pour objectif de conduire chaque élève au moins au C.A.P. coûte plus cher qu’un enseignement élitiste qui fonctionne comme une tour de distillation fractionnée en rejetant dans la vie active, bien avant la fin du Collège, des dizaines de milliers de jeunes sans qualification.
Le système éducatif constitue avant tout un investissement qui s’avère toujours rentable à long terme, tant l’inadaptation professionnelle et sociale coûte cher au contribuable, même si ce sont d’autres lignes budgétaires.
8 On ne peut donner un haut niveau de formation générale ou une qualification professionnelle à chaque élève qu’en diversifiant les parcours de formation en Collège.
On ne peut prendre en charge des élèves de niveaux aussi différents et traiter avec succès des difficultés aussi diverses par des méthodes d’enseignement quasiment uniformes et quelques heures de « soutien ». Il faut tenir compte de la personnalité, des compétences des élèves pour susciter et développer leur motivation. Seuls des enseignants formés à cet effet et disposant de personnes «ressource» appartenant à différentes professions peuvent y parvenir.
9 Il sera procédé à une réforme des programmes alliant actualisation des contenus, allégement, harmonisation intra et inter disciplinaire, mise en synergie des disciplines sur l’ensemble de la scolarité.
Des programmes noyaux nationaux dont les contenus doivent être acquis par tous les élèves seront définis à l’intérieur des programmes officiels.
Les élèves qui n’éprouvent pas ou peu de difficultés approfondiront l’ensemble du programme afin que le système éducatif leur permette de développer toutes leurs potentialités.
10 La préparation aux grands choix d’orientation nécessite que les élèves aient une idée précise des différentes voies de formation qui s’offriront à eux après le Collège et de leurs débouchés actuels.
Pour toutes ces raisons, on multipliera progressivement, dès la classe de 5 ème, les présentations (conférences, vidéo, etc.) des différentes voies de formation, les visites de Lycées professionnels, technologiques et d’enseignement général, d’entreprises.
Les élèves peu ou pas intéressés par l’enseignement général mais qui expriment une motivation pour la voie professionnelle pourront, dès la classe de cinquième, effectuer des stages de sensibilisation dans une formation professionnelle de L.P..
A l’issue de la classe de 5ème, les élèves motivés volontaires pourront, tout en conservant leur statut de collégien, accéder à une 4ème de découverte professionnelle 6 heures implantées en lycée professionnel ou, à défaut en collège (en partenariat avec les lycées professionnels du secteur). S’il s’avérait que cette formation ne corresponde pas à leurs attentes, ils pourraient alors regagner leur collège d’origine tant qu’ils n’auraient pas atteint l’âge de 16 ans, bénéficiant ainsi d’un véritable « droit à l’essai ».
Ils pourraient ensuite intégrer une 3ème « découverte professionnelle 6 heures » puis choisir un baccalauréat professionnel ou un CAP organisé par unités capitalisables leur permettant d’acquérir à leur rythme une qualification diplômante .
L’implantation d’internats dans les lycées professionnels ayant ouvert des classes de 4e et de 3e DP6 est de nature à favoriser, l’accès de ces classes aux élèves géographiquement éloignés.
11 Les jeunes en situation de refus scolaire et qui ne respectent pas les obligations faites aux élèves doivent être scolarisés dans des structures adaptées créées en nombre suffisant jusqu’à ce que leur niveau et leur comportement permettent une insertion profitable à tous, dans un collège ou un lycée.
C’est la seule façon de concilier obligation scolaire pour tous et droit de chaque élève à suivre une scolarité profitable pouvant le conduire au maximum de ses possibilités.
De plus, la lutte contre la déscolarisation ne passe pas seulement par la contrainte mais aussi par la diversification des modalités, des structures et des établissements d’accueil. Par exemple, en proposant des sections de remise à niveau aux jeunes ayant « décroché ».
C’est pourquoi les élèves en situation de refus du système scolaire d’enseignement général et professionnel pourront, sur leur demande et à partir de l’âge de 14 ans, choisir une formation en alternance sous statut scolaire combinée ou non avec un dispositif type « relais » ou C.L.I.P.A. Ils disposeront alors d’un droit de reprise de leurs études pour une durée au moins égale à celle restant à courir jusqu’à leur 16ème anniversaire.
A leur demande, ils pourront réintégrer leur collège d’origine ou un lycée professionnel dès lors qu’ils apporteront la preuve de leur motivation et qu’ils respecteront les obligations faites aux élèves par la Loi.
On veillera à ce que les élèves soient réintégrés dans des classes et structures correspondant autant que faire se peut à leur niveau et à leur âge.
Le refus persistant d’assumer les obligations contenues dans la Loi entraînera le placement dans un dispositif adapté, hors du Collège ou du Lycée professionnel.
La mise en place d’un «droit à l’essai», accompagné de la possibilité de retourner dans son collège d’origine, évite la reconstitution de filières étanches et garantit le respect de l’égalité des chances.
12 L’orientation, à quelque niveau qu’elle intervienne, doit s’effectuer sur des critères positifs de motivation et de compétences tout en tenant compte de la réalité économique afin de favoriser l’insertion professionnelle. L’enseignement des disciplines permettant d’exprimer des qualités différentes de celles révélées par les disciplines d’enseignement général doit donc être développé.
En effet, un niveau faible dans les disciplines d’enseignement général n’induit pas obligatoirement des compétences inversement proportionnelles dans des disciplines plus professionnelles. Un élève ne devrait donc pas être orienté contre sa volonté vers une formation professionnelle qui ne correspondrait pas forcément davantage à ses aptitudes.
Dès lors, choisi sur des critères de motivation et de compétences, l’enseignement professionnel cessera d’être considéré comme une voie de relégation et ses diplômes seront valorisés.
13 Comme pour les écoles, un ensemble de savoirs et de savoir-faire nécessaires à la poursuite des études dans chacun des trois types de Lycées sera défini pour le Collège.
A intervalles réguliers, un bilan des acquis des élèves du Collège sera réalisé, de véritables dispositifs d’aide et de rattrapage seront rapidement mis en place dès que des difficultés seront constatées. Les élèves seront alors pris en charge, selon l’importance de ces difficultés par des personnels formés à cet effet.
14 Les élèves éprouvant des difficultés plus lourdes et persistantes au cours de leur scolarité en Collège seront pris en charge, dans le Collège, par des enseignants spécialement formés s’appuyant sur une équipe pluriprofessionnelle dont la composition a été définie précédemment.
Le temps supplémentaire ainsi éventuellement passé en Collège au-delà des quatre ans de base ne consisterait pas, sauf exception, en année(s) de redoublement d’une classe. Il sera consacré à un rattrapage intensif des lacunes subsistant parmi les connaissances indispensables à la poursuite de la scolarité dans l’un des types de Lycée.
Pour une efficacité maximale le rattrapage s’effectuera dans des groupes à effectifs très réduits et selon une pédagogie adaptée à l’âge de ces élèves.
DECOUVREZ LA SUITE DE NOS PROPOSITIONS ICI…