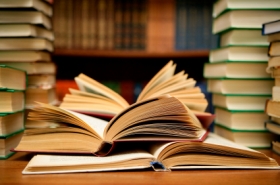Références
(pour tout problème légal, n’hésitez pas à nous contacter ) :
– Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 instaurant la notion de « missions particulières ».
– Décret indemnitaire n° 215-475 du 27 avril 2015 définissant les missions particulières et les taux de rémunération.
– Circulaire d’application n° 2015 – 058 du 29 avril 2015 publié au BO du 30 avril précisant certaines missions, cadre le contenu et les modalités d’attribution de l’indemnité.
I – UN PROBLEME STATUTAIRE
Bien que fonctionnaires d’Etat, les enseignants ne sont pas soumis à la règlementation relative au temps de travail appliquée généralement dans la Fonction publique, soit 1607 heures annuelles. Le décret n° 2014-940 permet de déroger pour ces personnels à la règle générale de la Fonction publique (comme c’était le cas en application du décret de 1950 qu’il remplace et qui a été abrogé avec effet à la rentrée 2015).
Dès le début des annonces de la réécriture du texte statutaire de 1950, le SNCL-FAEN a rappelé qu’il était très attaché aux différents statuts des enseignants et à leur aspect de protection des personnels. Nous rappelions aussi le refus de toute annualisation de leur service.
Le décret du 20 août 2014, complété notamment par une circulaire d’application devenait ainsi à la rentrée de septembre 2015 la règle pour l’organisation des services des enseignants, ouvrant le champ aux Indemnités Particulières et aux disparités de rémunération qu’elles permettent.
II – UNE SITUATION DEROGATOIRE
Le décret de 2014 l’indique clairement : il « reconnaît l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré ».
Le métier d’enseignant définit ainsi un service composé d’enseignement, de missions liées à l’enseignement et d’éventuelles « missions particulières ».
Le décret déroge aux dispositions habituelles des personnels de la Fonction publique en termes d’obligations réglementaires de service (ORS) en ce qu’il institue pour les enseignants un service maximum hebdomadaire sur l’année scolaire : 18 heures pour les professeurs certifiés et quinze heures pour les professeurs agrégés par exemple. Les enseignants pouvant se voir imposer 1 heure supplémentaire, mais une seule.
III – MISSIONS LIEES A L’ENSEIGNEMENT
Elles sont constituées des tâches inhérentes à l’enseignement et qui font la spécificité du métier : préparation des cours et corrections des travaux des élèves, aide et suivi dans le choix de leur projet d’orientation, relations avec les parents, travail au sein des équipes pédagogiques…
Ces missions étaient jusqu’alors laissées comme un travail invisible et à ce titre entretenaient le flou. Désormais, elles sont consignées et reconnues, contribuant à davantage de transparence sur leur contenu.
Il découle de ce principe que désormais toutes les heures d’enseignement se valent. Alors que naguère on distinguait les heures en classe entière et les heures à effectifs réduits, désormais toute heure effectuée devant des élèves (cours, groupe, soutien, TP, TD, TPE, chorale, etc) est décomptée pour une heure dans le service d’enseignement.
C’est ainsi que disparaît la majoration pour effectif faible ou au contraire sa minoration pour effectif pléthorique qui figurait dans le décret de 1950. Ce dernier dispositif est notamment remplacé par une indemnité unique au taux annuel de 1 250 €.
En revanche, un allègement de service d’une heure est conservé : heure dite « de vaisselle » pour les professeurs de physique-chimie et SVT en collège s’ils assurent au moins 8 heures d’enseignement et s’il n’y a pas de personnel de laboratoire dans l’établissement par exemple.
Attention : certains chefs d’établissement prétendent que ces heures statutaires peuvent être remplacées par une IMP. C’est FAUX et en contradiction avec le décret parce que cela revient à augmenter le service d’un grand nombre de professeurs. C’est inacceptable.
A noter : les heures consacrées à l’accompagnement éducatif et aux activités péri-éducatives ne sont pas concernées par le décret de 2014 et font donc l’objet d’une rémunération spécifique.
Heure de vie de classe : la circulaire n° 2015-057 prise en application du décret est très claire : cette heure « n’entre pas dans le service d’enseignement stricto sensu » car il ne s’agit pas d’une heure d’enseignement.
Sous prétexte que les enseignants continuent de percevoir l’ISOE pour les « missions liées », le ministère a entendu inclure cette heure dans les missions.
Le SNCL-FAEN exige l’intégration de toute heure de ce type dans le service actuel des professeurs.
IV – LES MISSIONS PARTICULIERES
C’est l’une des nouveautés du décret de 2014 que d’instaurer ces nouveaux types de missions.
Contrairement aux précédentes missions « liées », qui sont désormais définies comme faisant partie du service de l’enseignant, les missions particulières peuvent s’exercer au sein de l’établissement ou de l’académie sur la base du volontariat.
Elles peuvent conduire à l’attribution d’un « allègement » de service ou d’une indemnité pour mission particulière (la fameuse IMP).
A noter : les textes ne prévoient en aucune façon l’attribution d’une lettre de mission pour les missions particulières au sein de l’établissement, celle-ci étant réservée aux missions dans l’académie. Certains chefs d’établissement, par méconnaissance des textes ou sciemment, tentent d’imposer une lettre de mission. Ils prétendent ainsi conférer à la mission un caractère plus officiel mais il s’agit en réalité d’exercer une forte pression sur les enseignants. Cette lettre n’a aucune valeur autre que symbolique, elle doit être refusée !
Le SNCL-FAEN dénonce cette instrumentalisation des IMP pour en faire un outil de pilotage par le management des EPLE, contribuant à la mise en concurrence des personnels et au renforcement du pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie.
V – DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT ?
Ces missions particulières se déclinent selon 2 modalités, en établissement et dans l’académie. Elles recouvrent entre autres, des tâches qui étaient assurées dans le cadre des décrets de 1950 (entretien du cabinet d’histoire-géographie, du labo de sciences, de technologie, de langues). Elles ont été étendues aux coordinations de discipline, de niveaux d’enseignement,…).
A ces mesures s’ajoutent d’autres missions déjà existantes telles que celle de référent culture, référent décrochage scolaire, référent numérique et le tutorat des élèves en lycée.
A noter : aucune de ces missions ne peut être imposée aux professeurs. Ceux-ci doivent être volontaires pour les assurer, elles peuvent être refusées.
Dans le cadre des tâches reconnues pour le versement de l’IMP, (ci-dessus) l’enveloppe étant restreinte, les équipes éducatives et de direction sont contraintes de faire des choix dans les propositions d’attribution des différentes missions particulières. De fortes disparités apparaissent alors entre ce qui est rémunéré et ce qui ne l’est pas et à quel taux, conduisant à un marchandage indigne en matière d’éducation, et à de grandes injustices, un même travail pouvant être plus ou moins bien indemnisé d’un établissement à l’autre.
VI – Allègement ou IMP ?
Même si l’article 3 du décret n° 2014-940 prévoit la possibilité « d’un allègement de service », celui-ci est, dans les faits, devenu exceptionnel et laissé au bon vouloir de la hiérarchie.
Au sein d’un établissement, un enseignant ne peut bénéficier au titre de la même mission de l’IMP et de l’allègement de service.
Le SNCL-FAEN dénonce la propension du ministère à privilégier le régime indemnitaire au détriment de l’allègement, pourtant largement plébiscité par les enseignants qui préfèrent souvent disposer de davantage de temps de respiration.
Nous conseillons aux professeurs siégeant au conseil d’administration d’insister pour que cette seconde option soit privilégiée.
VII – MODALITES D’ATTRIBUTION
Les chefs d’établissement, contrairement à ce que pensent certains d’entre eux, ne sont pas libres de répartir les IMP en fonction de choix locaux.
Le conseil d’administration et le conseil pédagogique ont chacun leur rôle à jouer dans leur attribution. Le premier doit donner son avis sur l’attribution de ces missions particulières et sur les modalités de leur mise en œuvre après consultation du conseil pédagogique.
Certes, même si la participation de ces deux instances contribuent à une certaine transparence des opérations, il n’en reste pas moins que c’est le chef d’établissement qui propose les « décisions individuelles d’attribution » au rectorat.
Revers de la médaille, la présentation de ce régime indemnitaire aux membres du conseil d’administration (représentants des parents, des élèves, des collectivités) donne la possibilité à ces différents élus d’influer sur les rémunérations des enseignants. Il ne s’agit plus là de transparence mais d’ingérence.
Les IMP sont attribuées annuellement. Leur détermination s’effectue entre février et juin de l’année précédente pour la préparation de la rentrée suivante selon les modalités suivantes :
– les besoins de l’établissement sont recensés et présentés au CA par le chef d’établissement,
– les recteurs disposent d’une enveloppe académique d’IMP qu’ils ont la charge de répartir entre les établissements en fonction des orientations ministérielles et qu’ils déclineront selon les priorités académiques et les caractéristiques de l’établissement,
– l’enveloppe d’IMP est notifiée aux établissements en même temps que la dotation horaire globale.
Le SNCL-FAEN dénonce le financement des IMP par prélèvement sur l’enveloppe globale déjà largement insuffisante.
Ainsi, des personnels effectuant la même mission dans deux établissements proches ne toucheront pas automatiquement la même prime. C’est injuste et démotivant.
C’est pourquoi nous demandons aux élus au CA représentant les personnels enseignants de tenter d’imposer les choix de missions le plus étroitement liées à la pédagogie et à l’amélioration des apprentissages des élèves, ce qui est l’esprit de la circulaire d’application du décret de 2015. La coordination de disciplines et la mission de référent numérique sont indispensables dans les établissements et donc prioritaires.
VIII – Modalités de versement et taux des IMP
– une mission accomplie sur l’année scolaire ouvre droit au versement de l’IMP par neuvième à compter de novembre,
– l’indemnité est maintenue en cas d’absence pour congé de maladie ordinaire, congé de maternité, de paternité,
– le montant est le même selon que l’intéressé exerce à temps complet ou partiel,
– plusieurs collègues exerçant la même mission peuvent percevoir une IMP.
Les taux : ils sont de 5 montants annuels différents.
Basés sur le montant annuel moyen d’une HSA, soit 1 250 €, ils sont déclinés en 4 autres taux : 312,5 € / 625 € / (1 250 €) / 2 500 €/ 3 750 €.
IX – IMP : quelles conséquences ?
1 250 € c’est moins que le taux de la première HSA attribuée à un professeur certifié ou PLP de classe normale. La transformation des heures supplémentaires en indemnités a donc eu pour conséquence la baisse de leur pouvoir d’achat pour certains collègues et ne constitue surtout pas « l’avancée » que les annonces laissaient présager.
Rappelons qu’alors qu’ils ont connu une augmentation de leur charge de travail au fil des années, les personnels enseignants n’ont été concernés ni par le passage de 40 à 39 heures ni par la réduction du temps de travail à 35 heures.
Dans ces conditions, il n’est pas acceptable qu’il soit répondu à la baisse du pouvoir d’achat des enseignants par des primes diverses et le recours aux heures supplémentaires. Les primes conduiront à terme à une diminution du montant des pensions.
Le SNCL-FAEN est demandeur de hausses de salaire appliquées à tous et à une revalorisation totale du métier aussi bien dans ses aspects financiers que de conditions de travail.
Pour toutes interrogations, n’hésitez pas à contacter notre siège national : sncl@wanadoo.fr