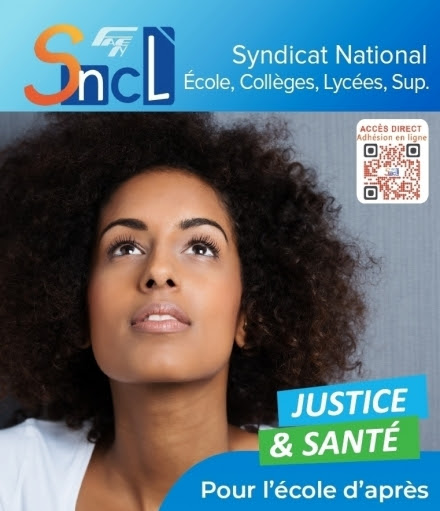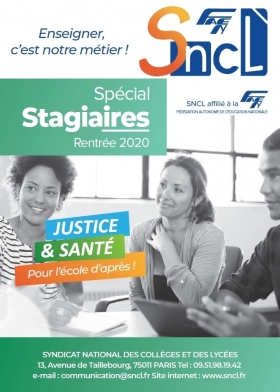Le concept de laïcité est très ancien ; mais le terme de « laïcité » n’apparaît, selon Antoine Prost, que dans le supplément du Littré de 1871.
Un peu d’Histoire
Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.» La laïcité implique la neutralité de l’Etat, garant des libertés.
L’enseignement public français repose sur le principe de laïcité, en vertu du 13e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Rappelons que ce préambule reste à ce jour toujours en vigueur, au même titre que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Tout habitant de ce pays est donc tenu de respecter le principe constitutionnel de laïcité et tout personnel de l’enseignement public doit transmettre et faire respecter à ses élèves, ce principe républicain.
La laïcité constitue d’ailleurs l’un des fondements de l’école publique française depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 (laïcité des programmes, laïcité des locaux) et la loi Goblet du 30 octobre 1886 : « L’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ».
La Loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 octobre 1905 étend la laïcité à toute la société.
Cet équilibre, difficilement obtenu, a souvent été confronté à des attaques de tous bords. L’Ecole, reflet de la société, n’a pas été épargnée, jusqu’à nos jours.
Il ne suffit donc pas de respecter la laïcité, de la transmettre, il faut aussi la défendre.
Notre action
C’est ce que notre organisation professionnelle (association puis syndicat) s’est toujours appliquée à conduire sans relâche, en toute indépendance, guidée par des mandats de congrès très clairs, depuis 110 ans.
Dès sa création
En 1910, 5 ans seulement après la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, lorsque fut créée l’Association Nationale du Personnel des Cours Complémentaires (ANPCC), la période héroïque de l’Ecole laïque était passée. Mais, dans de nombreuses régions, des situations de concurrence directe avec les écoles congréganistes, que venaient parfois exacerber des décisions politiques, persistaient. Ces situations furent maintes fois évoquées lors du premier congrès national de l’ANPCC.
Il fallait donc, encore et encore, affermir, organiser, faire vivre, cette nouvelle école publique laïque. Les fondateurs de l’ANPCC n’étaient pas des théoriciens de la laïcité, mais des praticiens de terrain, défendant, en priorité, leurs élèves et le cadre dans lequel s’exerçaient à l’époque leurs fonctions : les Cours Complémentaires. Cette structure offrait aux enfants des milieux défavorisés la possibilité d’élever leur niveau intellectuel et d’améliorer leur condition sociale.
Par ailleurs, le profil personnel de ces fondateurs de l’ANPCC montre qu’ils étaient très engagés dans des œuvres concrètes, associées à la promotion de l’Ecole laïque.
Période 1939-1945
Sous le Régime de Vichy, l’article 72 de la loi du 24 octobre 1941 prononce « la dissolution des anciens syndicats et groupements syndicaux et professionnels de toute nature ». Malgré les risques encourus, l’ANPCC, désormais clandestine, intervient à plusieurs reprises en 1943 pour éviter la suppression des Cours Complémentaires.
Si nos prédécesseurs n’étaient pas des théoriciens de la laïcité, ils n’en étaient pas moins mus par un idéal résolument laïque, comme le rappelle en 1945 Jean Sauzeau (Président de l’ANPCC) : « Nous devons faire comprendre à nos camarades que nous avons le même idéal laïque.»
De la Libération à la Loi Debré
Nombre de nos publications vont réaffirmer cet attachement à la laïcité et dénoncer les mesures tendant à favoriser l’enseignement privé.
Evidemment, l’ANPCC ne s’est pas contentée de déclarations solennelles, elle a aussi agi de diverses manières, comme en témoigne l’exemple suivant.
Le gouvernement collaborationniste de Vichy avait octroyé des aides financières à l’enseignement privé qui furent supprimées à la Libération.
Les établissements privés multiplièrent les pressions qui aboutirent en septembre 1951 au vote de la loi Marie-Barangé, accordant une subvention aux parents qui scolarisaient leurs enfants dans le privé.
Fort de cette première victoire, l’enseignement privé voulut pousser son avantage.
En janvier 1959, un projet de loi, qui devait aboutir au vote de la « Loi Debré » le 29 décembre 1959, fut rendu public. Il provoqua d’importantes manifestations.
Cette loi Debré, sur les rapports entre l’Etat et les établissements privés, prévoyait de financer ceux d’entre eux qui étaient volontaires, introduisant ainsi la notion d’établissements privés sous contrat.
Elle ouvrait donc une brèche dans la loi 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat. L’ANPCC s’y opposa et appela ses adhérents à participer aux manifestations qui furent organisées, notamment les 21 et 28 juin 1959.
Lors de la transformation de l’ANPCC en syndicat
Le 27 avril 1960, l’ANPCC se transforme en syndicat. Elle devient SNC (Syndicat National des Cours Complémentaires, puis Syndicat National des Collèges). Au 4e alinéa de l’article 4 des nouveaux statuts, il est stipulé : « Le syndicat a pour but la défense de la laïcité de l’enseignement public. »
Période 1981-1984
La création d’un « grand service public unifié et laïque de l’Education Nationale » faisait partie des 110 propositions du candidat Mitterrand élu Président de la République le 10 mai 1981. Le 14 mai, le congrès national du SNC formulait la demande de nationalisation progressive de toutes les structures éducatives bénéficiant de fonds publics.
Ce dossier ne fut pas considéré comme prioritaire par l’exécutif. Face à la mobilisation de l’enseignement privé, le camp laïque reste divisé, victime de ses vieux démons. Des alliés sincères et mobilisés tel le SNC sont marginalisés.
Face aux nombreuses provocations qui demandent la privatisation de l’enseignement public, notre syndicat réaffirme, lors de son congrès d’avril 1983, qu’un secteur privé d’enseignement n’est concevable qu’à la condition qu’il soit exclusivement financé par des fonds privés.
Le 18 octobre 1983, le ministre Savary adresse au SNC, ainsi qu’aux principaux autres syndicats, la nouvelle version de son projet de loi.
Le SNC déplore que celle-ci entérine un financement des établissements privés par des fonds publics, et dénonce l’abandon des engagements présidentiels. Il pointe le risque de dénationalisation de l’enseignement public et appelle les autres organisations laïques à refuser cette décision.
Au début de 1984, les associations de parents d’élèves du privé organisent d’importantes manifestations auxquelles répondent les défenseurs de l’enseignement public.
Le SNC appelle à ces manifestations. Il dénonce au Conseil Supérieur de l’Education du 27 mars une situation qui aboutirait à une privatisation larvée du service public d’éducation et compromettrait la démocratisation de l’enseignement.
Le 24 juin 1984, les tenants de l’enseignement privé organisent une importante manifestation qui prend une tournure politique avec la participation des leaders de l’opposition.
Le 14 juillet suivant, le Président Mitterrand rend hommage à Alain Savary mais annonce le retrait pur et simple du projet de loi, entrainant la démission du ministre et celle du Premier ministre.
1994 : grande manifestation contre le projet Bayrou
Depuis la rentrée scolaire de septembre 1993, des dizaines d’affaires, dites du foulard, perturbent la vie des collèges et des lycées. Il s’agit d’actions provocatrices concertées.
Le ministre François Bayrou publie une nouvelle circulaire, reprenant à la lettre la position du Conseil d’Etat.
Cette attitude ambigüe autorise le port de signes religieux discrets mais interdit celui de signes ostentatoires, laissant aux chefs d’établissements la responsabilité de déterminer la limite entre le discret et l’ostentatoire.
Le SNCL, (transformation du SNC en 1993), tout simplement laïque, dit non au port de signes religieux à l’Ecole, qu’ils soient discrets ou non.
C’est le moment que choisit le ministre pour déposer un projet de loi visant à abroger la Loi Falloux qui attribue la gestion et l’entretien des établissements privés à leurs propriétaires.
Une caricature de débat discontinu se déroule alors au Parlement, de juin à décembre 1993. Dès que le vote des sénateurs est connu, les organisations syndicales laïques organisent une grande manifestation à Paris le 16 janvier 1994.
Au travers de sa fédération, la FAEN (Fédération Autonome de l’Education Nationale), notre syndicat fut pleinement associé à la décision et à l’organisation de cette manifestation. Il contribua à son plein succès.
Près d’un million de défenseurs de la laïcité défilèrent ce jour-là, sur 12 kilomètres et pendant près de dix heures, dans le froid. Le Conseil Constitutionnel annula l’article supprimant la Loi Falloux.
Les organisateurs de la manifestation du 16 janvier, prudents, décidèrent tout de même de constituer un collectif de vigilance dénommé « Collectif du 16 janvier » chargé de lancer une grande pétition nationale appelant à poursuivre la mobilisation et à renforcer la vigilance par rapport aux collectivités locales.
Période 2003-2004
Depuis les premières affaires du « port du voile islamique » dans des collèges de l’Oise en 1989, et l’avis très imprécis du Conseil d’Etat qui ne faisait qu’ajouter au vide juridique, les incidents se multiplièrent et s’étendirent à l’ensemble du territoire national. Le SNC, puis le SNCL et la FAEN, demandèrent, par pragmatisme, le vote d’une loi interdisant le port de tout signe religieux.
Nous étions alors bien peu nombreux dans le camp laïque sur cette ligne. Nos argumentaires et nos actions persévérantes, ont convaincu de plus en plus de collègues, et au travers d’eux leurs syndicats.
De nombreuses interventions furent effectuées auprès des groupes parlementaires, des ministères concernés et des plus hautes autorités de l’Etat par la FAEN et un nombre croissant de syndicats. Cette convergence conduisit en 2003 le Président Jacques Chirac à lancer un processus qui devait aboutir, le 15 mars 2004, à la promulgation de la loi encadrant le port de signes et vêtements religieux dans les établissements scolaires.
Si le contenu de cette loi ne nous donnait pas entière satisfaction, il marquait tout de même un progrès sensible, que nos collègues purent constater sur le terrain. Il continua d’y avoir, ici ou là, quelques provocations, mais le nombre et la gravité des incidents diminuèrent considérablement.
La large mobilisation, en premier lieu du SNCL et de la FAEN, en faveur de la laïcité avait donc porté ses fruits.
Des militants et militantes ont ainsi, depuis 110 ans, donné de leur énergie, de leurs compétences et de leur vie, pour défendre leur métier et leurs collègues.
Pour honorer leur mémoire, une poignée d’anciens responsables nationaux du syndicat, désirant travailler ensemble, a créé, le 5 novembre 2019, l’association « Mémoire syndicale », grâce à l’aide du SNCL.
Celle-ci s’est fixé trois objectifs principaux :
- Rédiger des biographies pour un dictionnaire universitaire: le Maitron.
- Ecrire un ouvrage, sur plus de 100 ans, d’histoire du syndicat.
- Participer à la défense des principes républicains dont la laïcité.
« Mémoire syndicale » entend surtout tirer les leçons du passé, afin d’éclairer les décisions présentes et à venir.
|
Des attentats de Charlie Hebdo à Samuel Paty
Les attaques terroristes islamistes de janvier et novembre 2015 contre Charlie-Hebdo, une supérette casher, le Bataclan et ses environs, le stade de France, ont provoqué de véritables tueries (154 morts). Ces attentats n’étaient pas directement dirigés contre la laïcité à l’Ecole. En revanche, ils cherchaient à impressionner les esprits. Ils visaient à imposer la suprématie de préceptes religieux extrémistes. Ils niaient la tolérance, la liberté d’opinion et d’expression, tous les principes républicains auxquels nous sommes viscéralement attachés, donc aussi la laïcité.
C’est la raison pour laquelle, le SNCL et la FAEN ont très fermement condamné ces actes monstrueux, et appelé les personnels de l’Education Nationale à participer massivement aux rassemblements et aux marches républicaines organisés un peu partout en France. En janvier 2015, 44 chefs d’Etats défilèrent alors à Paris, avec plus d’un million et demi de citoyens.
Aujourd’hui, à travers Samuel Paty, auquel ce bulletin rend hommage, c’est bien l’Ecole et ses personnels qui sont directement touchés. Ceux qui sont chargés d’enseigner les principes de la République, et avant tout la laïcité, deviennent des cibles potentielles de la barbarie.
Face à cette escalade meurtrière, il est indispensable de rappeler notre attachement à la laïcité, comme nous le faisons à chacun de nos congrès, de s’indigner après les attentats, comme nous l’avons fait. Mais tout cela ne suffit plus.
C’est pourquoi, fidèle à sa tradition, le SNCL-FAEN interpelle aujourd’hui les élus et les autorités, en avançant 14 propositions constructives, pour permettre à l’Ecole de jouer pleinement son rôle dans l’éducation à la laïcité et au respect des principes républicains.
Article collectif rédigé par
Mémoire Syndicale
ANPCC-SNC-SNCL-FAEN
|